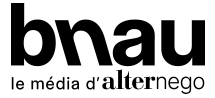La compétition a une histoire longue. On la fait remonter au-delà de l’époque antique et des premiers Jeux olympiques : des représentations de compétitions de lutte nous parviennent du IIIè millénaire avant J.-C.
Si cette histoire est longue, elle n’est pas linéaire pour autant. Car la compétition telle qu’on la connait, vouée à distinguer les gagnants des perdants, n’est pas un modèle unique. Il y eut même des périodes de l’histoire où gagner était une anti-valeur. Et si la variabilité historique du sens de la compétition était une inspiration pour envisager de nouvelles approches de la performance ?
Lancelot, ce loser ?
Au temps des Chevaliers de la Table ronde, être le meilleur n’est pas ce qu’on fait de mieux, nous dit l’historien médiéviste Michel Pastoureau. Aussi Lancelot du Lac que l’on figure aujourd’hui dans la pop culture comme un héros vaillant qui triomphe de tout est croqué avec beaucoup plus d’ironie par les auteurs de l’époque. Chrétien de Troyes ne le loupe pas, le plaçant à plus d’une occasion en posture ridicule, notamment dans l’épisode de la charrette d’infâmie. C’est qu’à l’époque féodale, réussir n’est pas une vertu. Accomplir des prouesses non plus. Ce qui a de la valeur, c’est de respecter le code d’honneur.
Aussi, les Tournois « sportifs » du Moyen Âge n’ont pas tant vocation à discriminer vainqueurs et vaincus qu’à faire démonstration de la maîtrise des codes et gestes par les combattants.
Le sport, un support de projection
Les historiens qui se sont penchés sur le sport à travers les âges s’accordent volontiers pour dire que le sport est un support de projection civilisationnelle : il est investi de valeurs morales et d’attentes politico-sociales. Il s’inscrit donc invariablement dans des systèmes de croyances relatifs au contexte (historique, géographique, politique, culturel…).
Ainsi, dans la Grèce antique, le sport est clairement relié au sacré et sa pratique se rapporte à l’affirmation d’une exception hellénique par comparaison aux barbares. De ce fait, c’est aussi un enjeu de défense de la civilisation grecque face à la menace extérieure.
On retrouvera une association entre la puissance militaire et les valeurs attribuées au sport dans l’Europe des débuts du XIXè siècle : c’est dans la construction du « mythe de la nation en armes » que se situe l’intégration dès l’école de l’éducation physique dans le corpus de l’instruction des futurs citoyens. Cette conjonction des valeurs sportives et des valeurs militaires est particulièrement exacerbée par le fascisme italien, nous dit l’historienne Angela Teja. Et l’on pourrait étendre la remarque à d’autres régimes autoritaires.
Au titre des projections socio-politiques, on pourrait encore citer avec l’historien Patrick Clastres, l’hygiénisme et l’élitisme promus au cœur de son siècle par Pierre de Coubertin (où l’on projette le sportif en figure de l’homme idéal, sain de corps et rationnel d’esprit) ; avec le sociologue Norbert Elias, la contenance de la violence dans une époque post-Seconde guerre mondiale (où l’on promeut un universalisme pacificateur qui se réaliserait dans le « fair play ») ; avec la philosophe Isabelle Queval, le dépassement de soi dans un début de XXIè siècle imprégné de l’imaginaire entrepreneurial comme modèle de réussite voire de génie !
Bref, il n’y a pas de valeurs inhérentes au sport, rappellent les différents universitaires qui se sont penchés sur la question. Mais le sport est investi de croyances et de vertus qui résonnent avec des idéologies, au sens propre du terme, c’est-à-dire des catégories de pensée employées dans l’analyse de la réalité et servant la définition d’un idéal.
Il n’y a pas de valeur inhérente au travail non plus
Tout comme le sport, le travail ne possède pas de valeurs inhérentes. Selon les époques et les cultures rappelle l’économiste Annie Jacob, c’est l’effort ou au contraire l’aisance, le savoir-faire ou la qualité du résultat, la loyauté (au corps de métier ou à l’employeur) ou la rapidité d’exécution, l’utilité (matérielle, financière ou sociale) ou la technicité, le dynamisme ou l’expérience, l’esprit d’équipe ou le brio individuel, l’abnégation ou l’autonomie, la patience ou la réactivité etc. qui ensemble ou séparément composent le corpus de ce que chacun appellera la « valeur travail » — ou sur un ton moins moral, le professionnalisme — sans se rendre compte que cela n’est que l’expression d’un contexte civilisationnel .
Toutefois, on ne peut pas se voiler la face sur ce que nos économies actuelles charrient de valeurs associées au travail. La pression du chiffre qui procède directement du capitalisme financiarisé fait une place de choix, si elle n’accorde une position hégémonique à des critères tels que la combattivité, l’efficacité, la vélocité, l’engagement ou l’autorité. On a beau défendre depuis une vingtaine d’année les fameuses « soft skills » comme contrepoids aux valeurs de la gagne sans vergogne, chacun ressent bien que ces compétences douces ont davantage une place de cerise sur le gâteau que d’ingrédient principal.
Et puis, c’est comme si la « soft skill » peinait à trouver sa gestuelle. On la ramène encore trop volontiers au tempérament, aux qualités personnelles, aux valeurs de l’individu. Alors qu’évidemment, les compétences dites de « savoir-être » n’ont et n’auront de valeur dans le jeu de la reconnaissance du travail qu’à condition d’être considérées comme professionnelles, à l’équivalent d’un savoir-faire technique ou de la maîtrise d’une méthode ou d’un geste.
Un équilibre compétition/beauté du geste est-il possible ?
Dans le sport comme sur le terrain du travail, tout se passe comme si, à notre époque, la compétition se cherchait un équilibre entre le pouvoir de gagner et la beauté du geste.
Est-ce seulement possible ? Le sport ne s’en sort pas si mal qui sait reconnaître et parfois même saluer avec plus de ferveur le beau geste que l’exploit. On retient par exemple l’image bouleversante des athlètes néozélandaise et américaine Nikki Hamblin et Abbey d’Agostino aux Jeux de Rio. La première a fait chuter la seconde en trébuchant au dernier kilomètre des 5000 mètres. Cette dernière aurait pu être fâchée qu’on lui fasse ainsi perdre du temps. Mais au lieu de cela, dès qu’elle s’est relevée, elle a aidé sa concurrente à se remettre debout. Mais quelques instants après, l’Américaine qui a tendu la main à la Néozélandaise est victime d’une déchirure. Alors, sa rivale va l’emmener jusqu’à la fin de la course, en l’encourageant mieux que si elles faisaient partie de la même équipe. Et même si l’Américaine quitte ce jour-là le stade sur un fauteuil roulant, les deux femmes ont décroché leur place en finale.
Autre histoire de beau geste et de compétition, dans un match de football en Arabie saoudite : quand un gardien de but tenant le ballon ne peut pas dégager car son lacet est défait, c’est l’attaquant de l’équipe adverse qui se met à genou pour lui resserrer ses chaussures. L’arbitre déclare malgré tout le coup franc, considérant que les 6 secondes règlementaires ont été dépassées. Mais le tireur qui pourrait bénéficier de cet avantage décide délibérément d’envoyer le ballon en sortie de but. Est-ce à dire que le beau geste est une forme de contestation de la règle et de son incarnation arbitrale ? D’autres exemples de l’histoire du sport accréditent volontiers cette hypothèse du caractère intrinsèquement subversif — au frontières de l’antijeu — du beau geste dans l’espace compétitif.
Défendre la beauté du geste
Pourtant, à l’ère de la fin des records qui de fait attaque sérieusement le principe de compétition, il va bien falloir se reposer la question de ce qui fera demain « l’esprit sport » tout autant que « l’esprit travail ». Pour mener cette réflexion, on ne pourra évidemment pas s’en tenir à l’exception de la main tendue, de la démonstration épatante de fair-play, du « beau geste » comme un acte philanthropique dont la valeur se mesurerait à sa rareté et à son caractère spectaculaire.
Il nous faut en effet penser le sport et le travail comme une autre activation de l’effort et une autre représentation de la performance. Il n’est pas forcément nécessaire d’inventer quelque chose de nouveau. On peut aussi réactualiser ce qui a existé. Comme dans le sport où aujourd’hui comme au temps des Chevaliers, la maîtrise technique et l’élégance du jeu deviennent parfois plus importantes que le résultat : les « belles actions » du match au foot, la fluidité d’un service au tennis, la foulée aérienne d’un athlète font (et feront sans doute demain) le spectacle mieux que le panneau de score et le chrono.
Le travail aussi gagnerait à se repenser par le geste. Le geste de l’artisan, que tant de « quitters » post-CoViD ont voulu retrouver en quittant les bureaux pour l’atelier ? Pas seulement, car ce geste-là, manuel et projeté dans la satisfaction du « faire » (pour reprendre le mot si juste du sociologue Michel Lallement) n’est que le symbole de ce que l’on attend du travail en ces années 2020 : une action qui porte à conséquence, dont on comprend la signification, dont on mesure les implications, que l’on inscrit dans une chaîne de valeur. En conscience, en responsabilité. Et en fierté.
Nous prenons aussi le pari que rendre sa place au « geste », en tant qu’acte signifiant et impactant, c’est aussi rehausser le niveau de lucidité sur les externalités sociales et environnementales de nos activités. Une piste plutôt encourageante pour faire de chacun de nous depuis sa position d’acteur économique un « agent agissant » du changement, projeté dans tout son écosystème.