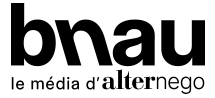En économie, il y a ce qui se comptabilise… Et ce qui ne se comptabilise pas, alors même que ça compte !
Marie Donzel, experte innovation sociale, rappelle la définition des externalités en économie pour proposer d’engager une réflexion collective sur la redéfinition de la valeur.
Les externalités, c’est l’ensemble des impacts de l’activité économique qui, soit n’entrent pas dans l’évaluation de la performance des agents, soit dont la valeur détruite ou produite n’est pas estimée à la hauteur de leurs effets.
Externalités négatives/positives
Les externalités peuvent être négatives : pollution et autres dégâts sur l’environnement liés à la production, au transport, aux déchets ; coût social engendré par de mauvaises conditions de travail ; pertes de chance pour les individus et la société attribuables à des systèmes inégalitaires ; destruction d’un tissu de capacités productives consécutive à des délocalisations, dégradation de la confiance collective par l’extension d’une culture déshumanisante du « coûte que coûte »…
Les externalités peuvent aussi être positives : élans de générosité et solidarité qui font « tenir » la société quand une crise la déstabilise ; mais aussi, au long cours, éducation et culture qui contribuent au développement du niveau général de la population (permettant aux entreprises de bénéficier de ressources humaines bien formées) ; pacte social nourrissant le sentiment de confiance nécessaire à l’engagement de chacun·e dans des projets collectifs (dont celui d’une entreprise) ; efforts de recherche fondamentale transférable en technologies commercialisables ; ou plus trivialement (en apparence), travail domestique garantissant le (ré)confort et le ressourcement indispensables à la « reconstitution de la force de travail »…
Un triple enjeu : économique, politique et éthique
La question des externalités soulève trois problématiques : l’une d’ordre économico-comptable, la deuxième de nature politique, la troisième d’essence philosophique.
Sur le plan des sciences économiques, l’enjeu est de bâtir des indicateurs permettant d’évaluer la valeur produite ou détruite. Dès les années 1950, James Meade s’intéresse aux impacts positifs de l’activité de l’apiculteur qui profite directement aux agriculteurs de proximité, quand ses abeilles pollinisent leurs champs. En 2005, les économistes de la FAO ont établi à équivalent 153 milliards d’euros cet apport indirect de l’apiculture à l’économie agricole. Autre exemple : les travaux de Joseph Stiglitz ont permis d’estimer à un gros tiers du PIB mondial la valeur du travail domestique et familial « gratuitement » effectuée par les femmes (à 70%) et les hommes dans les foyers. Ou bien, en matière d’externalités négatives, les chercheurs Mathis Wackernagel et William Rees, « pères » de la notion d’empreinte écologique ont développé une méthode permettant de comptabiliser les nuisances environnementales des activités des agents.
Cette comptabilité environnementale est aux origines de nouveaux paradigmes des politiques publiques en termes de considération des externalités. Pour synthétiser à très gros traits, on dira que du début du XIXè siècle jusque dans les années 1960, le principe est celui de l’Etat, qui prélève l’impôt et assure en contrepartie le développement des « communs » dont l’économie a besoin pour fonctionner : sécurité, santé, éducation etc. Mais que faire de la protection de l’environnement, à la fois menacé par la surexploitation des ressources naturelles et la pollution (deux externalités négatives majeures) ?
Trois grands leviers sont identifiés :
- la norme qui pose obligations & interdictions de certaines pratiques avec sanction en cas de non-respect ;
- la fiscalité qui touche au portefeuille des agents pour les décourager de s’adonner à des activités destructrices de valeur commune (taxe sur le transport aérien, le tabac..) ou au contraire les inciter à contribuer à la production d’externalités positives (par exemple : déduction pour l’amélioration énergétique du logement, les dons aux associations etc.) ;
- le marchandage, concrétisé notamment par le système des « droits à polluer ».
Si aucun de ces leviers ne s’avère complètement efficient pour réduire massivement les externalités négatives, on peut affirmer qu’ensemble, ils auront contribué à conscientiser le monde économique sur la question des impacts indirects, en témoigne la généralisation de l’admission de principe de la RSE au tournant du XXIè siècle.
Reste la question philosophique sous-tendue par la prise en compte des externalités : celle de la valeur. La tentation réflexe de convertir en équivalent unités monétaires le « prix » de la valeur créée ou dégradée n’est pas sans poser de problème éthique… Pour le comprendre en un exemple : de savants calculs ont permis d’élaborer le prix d’une vie humaine, indicateur d’aide à la décision pour différents acteurs ayant à se prononcer de façon plus ou moins directe sur divers risques mortels. En France, aujourd’hui, une vie humaine, ça vaut 3 millions d’euros. En moyenne. Parce que la méthode de calcul repose sur ce que nous représentons pour l’économie : elle se base notamment sur ce que perdre un·e humain·e coûte en termes de manque-à-gagner pour le marché de la consommation et de ressources plus ou moins précieuse pour le marché du travail, ainsi que de perte de revenus fiscaux pour l’Etat et les collectivités… Pas besoin d’un interminable sous-texte pour entendre que la vie humaine des nanti·e·s « vaut » plus. Glaçant, non ? Et parfaitement en contradiction avec la notion même d’humanité et les valeurs démocratiques, évidemment.
Ce qui nous amène à un véritable dilemme : certaines choses ont une valeur inestimable (la vie humaine, les sentiments, les relations, l’altruisme…) mais comment valoriser ce que l’on ne sait pas estimer ? Un casse-tête pour l’économie d’avenir. A moins bien sûr que l’on se repose la question de l’estime, justement. La trajectoire d’un mot venu de la langue marchande du XIIIè siècle et ayant évolué vers le lexique de la considération humaine ouvre des pistes de réflexion pour repenser notre rapport à ce qui « compte ».
Marie Donzel, experte innovation sociale