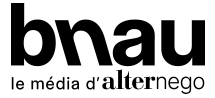Samedi 7 décembre 2024, 19h10 dans la tour sud de la cathédrale, la cloche la plus grande du monument sonne un moment historique. Puis, c’est au tour de Laurent Ulrich, l’archevêque de Paris de mener la danse : il frappe trois fois sur les portes centrales et voilà qu’au troisième coup, celles-ci s’ouvrent sur l’intérieur reluisant de la cathédrale.
Cinq ans après le drame de l’incendie qui a ravagé la chapelle et sa flèche emblématique, Notre Dame renaît de ses cendres. Ce soir-là, près de 4000 spectateurs de toutes religions, langues et cultures se rassemblent sur le parvis, émerveillés face à la splendeur du monument. Ensemble, ils célèbrent la reconstruction de ce lieu de culte mais aussi l’aboutissement d’une réédification d’une envergure exceptionnelle. Alors quels enseignements peut-on tirer de ce chantier du siècle pour le monde du travail ? Tour d’horizon.
La diversité des savoir–faire
Avec plus de 2000 artisans et une vingtaine de corps de métiers différents, le succès des travaux de la cathédrale témoigne bien de l’importance de la diversité des aptitudes. C’est même un levier clé pour tout projet d’après Charlotte Ringrave, experte en management et coopération. « Plus une équipe est diversifiée en termes de savoir-faire et de compétences, plus elle a de chances d’explorer des solutions originales et de générer de la valeur. », affirme la spécialiste.
Car c’est bien grâce à cette complémentarité des expertises que l’intelligence collective se déploie pleinement. Elle permet un effet de synergie, où chaque contribution enrichit la réflexion commune, stimule la créativité, croise des perspectives variées pour innover, et renforce la résilience et l’agilité des équipes face aux défis. Le tout en mobilisant un large éventail de ressources et de solutions. Cependant, il convient de garder à l’esprit que réunir des compétences variées autour d’un projet, pour que la coopération soit efficace, ne suffit pas. « En effet, la coopération est un processus exigeant, pas tout à fait naturel, qui doit s’organiser et se co-construire pleinement », analyse Charlotte Ringrave. Pour cela, il est primordial de structurer le cadre et les modes de travail pour favoriser l’entraide, la confiance, l’autonomie, la responsabilisation de chacun et la régulation des difficultés. Alors, la diversité des profils pourra se transformer en un véritable levier d’innovation et de performance collective.
Le pouvoir de la reconnaissance
Durant ces nombreux mois, le travail des artisans sollicités pour l’occasion a pu être documenté et exposé au grand public. Et les passants ont notamment pu découvrir plus d’une trentaine de photographies tirées du chantier, et réalisées par le photojournaliste Patrick Zachmann. Cette exposition en plein-air a ainsi permis de mettre en lumière les différentes étapes des travaux, mais aussi de témoigner de la reconnaissance accordée aux artisans. Rappelons-le, cette reconnaissance est essentielle pour les salariés et renforce leur engagement.
En effet, selon une étude menée par Gallup en 2022, 67 % des employés se disent plus motivés, et donc plus productifs, lorsque leurs efforts sont valorisés. Et ça, la politique l’a bien compris, puisqu’aujourd’hui, les métiers d’art bénéficient d’un regain d’intérêt et de moyens financiers pour les accueillir. Olivia Grégoire, alors ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme affirmait d’ailleurs : « À l’heure où l’économie se transforme sous l’effet des mutations technologiques, climatiques et sociales, on pourrait croire que les métiers d’art, ces savoir-faire anciens, sont menacés d’obsolescence : au contraire, ils n’ont jamais été autant d’actualité. » Et pour soutenir ces derniers, le gouvernement avait déployé pour la première fois en 2023 une stratégie nationale consacrée uniquement à ces savoir-faire artistiques. Un projet qui permettrait notamment de donner aux métiers d’art les moyens et les capacités de se structurer véritablement en filière d’ici fin 2025.
L’apprentissage de la coopétition
Par ailleurs, le chantier de Notre-Dame a prouvé que des entreprises concurrentes peuvent collaborer pour atteindre un objectif commun. (Re)mettant ainsi au goût du jour le principe de « coopétition » ! Popularisé en 1996 par deux auteurs américains, Barry Nalebuff et Adam Brandenburger dans leur ouvrage La Co-opétition : Une révolution dans la manière de jouer concurrence et coopération, ce modèle est fondé sur l’idée que la coopération peut être bénéfique pour des concurrents, et en ce sens une alternative privilégiée à la compétition. Il permet notamment de réduire les coûts de R&D, gagner en innovation grâce au partage des compétences ou encore accéder à des nouveaux marchés.
Ainsi, pour la reconstruction de la première partie de la flèche de la cathédrale, quatre petites et moyennes entreprises ont mené à bien les travaux de reconstruction. L’entreprise spécialisée en charpentes Le Bras Frères fut mandataire du chantier et hébergea les salariés de Cruard Charpentes, Asselin, et les Métiers Du Bois. Thomas Chesneau, employé de Le bras Frères affirmait : « Le chantier est exceptionnel donc unir nos forces et nos meilleures compétences s’imposait à nous. C’était inhabituel, il pouvait y avoir des interrogations sur la manière dont ça allait se passer, sur les techniques des uns et des autres, les caractères ou la culture d’entreprise mais elles ont vite été effacées. »
La réunification du “faire” et du “penser”
À l’image de l’artisanat, le chantier de Notre-Dame a incarné une mission collective qui dépasse les intérêts individuels et permet une vision concrète du “produit fini”. Et cela a son importance. Selon Matthew B. Crawford, dans son ouvrage Éloge du carburateur (2016), la perte de sens qui habite bon nombre de salariés pourrait justement être liée à la séparation entre le « faire » et le « penser » dans les activités professionnelles. L’une des principales sources de fierté au travail résiderait ainsi dans la réalisation complète d’une tâche : pouvoir la concevoir intellectuellement, l’anticiper dans son ensemble et la contempler une fois terminée. Une demande plus que présente aujourd’hui : d’après une étude d’Audencia et Jobs that makesense, menée en 2022, 92 % des salariés souhaitent trouver une valeur significative dans leur métier. Dès lors, le chantier de Notre-Dame incarne un modèle d’association du « faire » et du « penser », où chaque acteur du projet a non seulement contribué à la réalisation d’un chef-d’œuvre matériel… Mais a aussi pu s’investir intellectuellement dans le processus créatif jusqu’à son aboutissement.
L’importance du récit pour embarquer
Enfin, le chantier de Notre-Dame offre une précieuse leçon managériale sur la capacité à transformer une contrainte en un défi motivant. Souvenez-vous : le 16 avril 2019, au lendemain de l’incendie qui a ravagé la cathédrale, le président Emmanuel Macron lance une promesse qui semble irréaliste, presque déconnectée de la réalité : reconstruire Notre-Dame en cinq ans. Et pour faire face à ce défi colossal, c’est le général Jean-Louis Georgelin qui a pu donner à cet objectif une forme concrète et réalisable. « Ce responsable, c’était la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, par sa volonté, sa capacité à mobiliser et à fédérer les énergies », a expliqué le président de l’établissement public chargé de la reconstruction de Notre Dame, Philippe Jost. Autrement dit, le bon manager est celui qui rassemble autour d’un projet commun, inspire et donne du sens à ses équipes. Et pour se faire, quel meilleur outil que le pouvoir du récit ?
Gabrielle Pastel