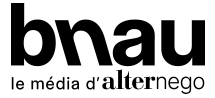Le terme « racisé·e·s » s’est installé dans les discours. Non sans déranger. Revenons sur l’origine de ce terme que les correcteurs automatiques soulignent de rouge comme un vilain barbarisme (quoique le Robert l’ait fait entrer dans ses pages depuis 2019), afin de mieux comprendre les tenants et aboutissants du débat et faire avancer la réflexion et surtout l’action contre le racisme.
Les non-dits et autres impensés de L’idéologie raciste
Le mot « racisation » apparaît pour la première fois dans l’ouvrage L’idéologie raciste, genèse et langage actuel de la sociologue Colette Guillaumin, paru en 1972. Guillaumin note que si la science a démontré l’inexistence des « races » au sein de l’espèce humaine, l’idé(ologi)e selon laquelle l’humanité se divise en groupes hiérarchisés en fonction de la couleur de peau, le morphotype ou les origines réelles ou supposées n’a pas quitté les mentalités collectives. Ainsi le racisme a-t-il survécu à la disparition de la « race ». Et ce n’est pas une mauvaise affaire pour les groupes sociaux qui ne subissent pas le racisme et ses conséquences socio-économiques : un boulevard pour le déni, explicite la sociologue Adia Harvey Wingfield. Loin de ces chercheuses l’idée de réhabiliter la « race » pour pouvoir regarder le racisme en face. Mais il faut trouver les mots pour le dire, et des mots qui mettent en évidence des systémiques et dynamiques.
Guillaumin a proposé « racisation » pour qualifier le processus par lequel un groupe majoritaire ou dominant, du fait d’un impensé de sa propre condition, désigne le « différent ». En d’autres termes, la racisation, c’est le fait de fabriquer « l’autre » en fonction du référentiel « Blanc* », et à partir de là identifier cette « diversité ethnico-culturelle » qu’on entend « assimiler », « intégrer » ou « inclure » selon les mutations de la terminologie qui accompagnent celles de la doctrine.
De la racisation comme dynamique structurelle au substantif « racisé·e » comme essentialisation
Racisation va donner « racisé·e », comme substantif ou épithète. Et c’est là que les choses commencent à se gâter ! « L’être racisé » nous dit l’universitaire Sarah-Jane Fouda est assigné et essentialisé deux fois : d’abord via la désignation par son origine réelle ou supposée et ensuite par le présupposé qu’elle est victime de racisme, avec toute la condescendance confite de bonnes intentions qui peut aller avec. Et de nous inviter à bien faire le distinguo entre « se faire raciser » (c’est-à-dire faire l’objet de racisme) et être considéré·e comme « racisé·e », ce qui constituerait une forme de racisme en soi.
L’écrivaine Chimamanda Ngozi Adichie exprime cela avec puissance, à travers la voix d’Ifemelu, l’héroïne du roman Americanah, qui se découvre « Noire* » à son arrivée aux États-Unis, quand des « Blancs* » parfaitement bien intentionnés et volontiers militants anti-racistes lui adressent non seulement une couleur de peau qu’elle n’a pas eu à penser comme un marqueur prioritaire de son identité jusque-là mais aussi des problèmes « de Noir·e·s* » avant même qu’elle les ai affrontés. Et tout le lot d’obligations implicites qui s’ensuivent : faire de son expression une « voix » des droits civiques, de ses cheveux tressés ou crépus plutôt que défrisés un symbole de l’affirmation d’un « oser être soi », de sa réussite socio-économique un exemple pour sa « communauté » (mais laquelle ?) et une démonstration que « la diversité est une richesse ».
La productrice de France Culture Louise Tourret, commentant le houleux débat qu’a engendré « l’affaire du camp décolonial » de Reims en 2016 conteste aussi l’usage abusif du terme « racisé·e », le considérant vidé de sa substance sociologique quand il ramène une question d’inégalités et de discriminations (certes touchant statistiquement davantage les personnes dites « issues de l’immigration » ou « descendantes des populations colonisées » ou bien seulement considérées comme telles) à un aperçu d’apparence charriant un lourd bagage de stéréotypes… Stéréotypes racistes (hostiles ou « bienveillants ») qui font volontiers écran à d’autres biais et d’autres réalités socio-économiques, corrélées ou non. Et Tourret de plaider pour qu’on appelle un chat un chat : ce que le langage courant appelle aujourd’hui une personne « racisé·e » est en réalité une personne victime de racisme.
Penser la condition de victime (du racisme et autres) hors des fantasmes de « victimisation »
Sauf que dès que le mot « victime » est prononcé, le terrain est désormais miné par une rhétorique « anti-victimaire » en vogue, qui consiste à faire peser sur celles et ceux qui parlent du vécu et du ressenti douloureux des discriminations et autres violences, le soupçon d’un bénéfice à tirer de la « condition » de victime.
Adossée à des lectures hâtives, si ce n’est orientées, de la littérature sur la « victimisation », depuis les écrits de René Girard sur la bouc-émissarisation jusqu’à la bibliothèque de l’analyse transactionnelle (où l’on trouve notamment le fameux « triangle dramatique » de Karpman) en passant par les travaux du père de l’école française de psychosociologie Serge Moscovici sur les phénomènes victimaires, cette approche de la victime comme suspecte de tentatives de manipulation n’aura été qu’alimentée par des scandales médiatisés de faux témoignages… Bien plus édifiants et excitants pour l’imaginaire collectif que ne l’est l’ordinaire quotidien d’un plafond de verre cimenté par les stéréotypes, les assignations essentialistes, les sentiments d’infériorité intériorisés, les micro-vexations et autres intimidations intentionnelles ou non, l’autocensure…
Pourtant, pour bien parler de racisme, ce qui est un préalable à agir efficacement contre le racisme, il va falloir faire état sans fard du fait que le racisme fait des victimes. Tous les jours. Des victimes qui en meurent, comme Trayvor Martin ou George Floyd et tant d’autres partout dans le monde. Des victimes qui ont peur. Des victimes qui n’ont pas accès à l’égalité des chances. Des victimes dont les libertés sont entravées par des conditions socio-économiques (logement, emploi, scolarisation, information, droits, sécurité…) dégradées à la faveur de persistance de préjugés que l’on aurait tort de ne plus vouloir nommer.
A la philosophe Hannah Arendt, laissons ainsi le mot ultime de cette tentative d’éclairage du terme « racisé » et des questionnements qu’il suscite : « Les mots justes prononcés au bon moment sont dans l’action. » Le bon moment est arrivé.
Marie Donzel, avec la précieuse relecture de Valentine Poisson
* Conformément au code typographique en vigueur, nous écrivons les substantifs « Blanc » et « Noir » avec une majuscule, à l’équivalent des gentilés et noms de nationalité. Cette logique de la lettre capitale désignant les habitant·e·s et ressortissant·e·s d’un lieu appliquée aux « ethnonymes » est cependant discutable.