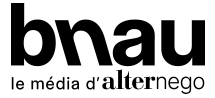Personne ne dira le contraire, le sujet des origines est délicat à aborder en France (et donc en entreprise). Cela s’explique entre autres par l’analyse de notre passé colonial : le fait d’être taxé de « raciste » renvoie tout de suite à une acception bien plus lourde à porter que l’âgisme par exemple (encore relativement admis dans notre société).
Évidemment, nous ne sommes pas tous racistes. Pour autant, nous sommes tous biaisés ! En cela nous ne sommes pas coupables, loin de là, mais nous sommes en revanche responsables de travailler sur les persistances de ces biais, qui se larvent parfois dans des détails.
Les micro-agressions raciales
On appelle micro-agressions tous les comportements ou les propos exprimés de manière anodine, mais perçus comme stigmatisants par la personne ou la communauté qui en fait l’objet. Il est très important ici de noter que ces micro-agressions ne correspondent pas forcément à une intention consciemment hostile.
C’est-à-dire qu’il y a parfois un décalage entre notre intention et son impact, qui peut finir par faire plus de mal que de bien à nos collègues. Le fait d’appartenir à un groupe stigmatisé (ici celui des personnes susceptibles de subir du racisme) renforce le risque de posture défensive car nous internalisons l’image négative que la société porte sur nous, ce qui peut expliquer parfois l’existence d’un décalage entre un propos et la façon dont celui-ci sera reçu.
Alors, comment parler de nos différences sans donner le sentiment de stigmatiser ? Quelles sont les phrases à éviter avec un collègue racisé ?
« Tu viens d’où ? »
L’intention de cette phrase est de montrer que l’on s’intéresse à notre collègue et que l’on cherche à mieux le comprendre. Ce qui, en soi, est extrêmement sain !
Le problème est que l’on marque ainsi inconsciemment une frontière entre le « dedans » (la culture nationale) et le « dehors » (la culture extérieure), et que cette question relègue fatalement notre collègue au monde du « dehors ». En termes d’impact, cela peut générer chez lui un sentiment d’exclusion (car « si tu viens d’ailleurs, c’est que tu ne viens pas d’ici »), ce qui devient notamment très problématique quand on est bel et bien français. De fait, en posant la question, on ne s’attend pas à ce que notre collègue nous réponde « d’Issy les Moulineaux » ! L’autre risque, en fournissant la fameuse réponse attendue, est que l’on puisse craindre d’être rangé dans une case qui n’est pas forcément celle à travers laquelle l’on se définit soi-même. À noter que cette question risque d’autant plus d’être vécue comme une micro-agression quand elle n’est adressée qu’à une seule personne dans un groupe (par exemple un tour de table en début de réunion), ou quand elle est posée trop tôt (lorsque l’émetteur et le destinataire ne se connaissent pas suffisamment bien).
Le bon réflexe : gardez en tête que la couleur de notre peau ne présage pas de notre « culture majoritaire ». Avant de poser la question, demandez-vous si la réponse est vraiment pertinente (« en quoi est-ce utile de savoir ? Qu’est-ce que ça va changer dans mes interactions avec ce collègue ? »). Si votre objectif est de mieux le connaître, vous pouvez éventuellement reformuler en « tu as grandi où ? », ce qui ouvre un répertoire à la fois plus large et intéressant vis-à-vis de son expérience personnelle. Dans ce cas, sachez vous satisfaire de la réponse, même si elle n’est pas aussi « exotique » qu’attendue. L’idéal reste toutefois de faire patienter votre curiosité pour laisser votre collègue aborder le sujet par lui-même (s’il le souhaite). S’il ne le fait pas, cela peut vouloir dire que l’information n’est pas déterminante pour lui… Et donc pour vous !
« Je suis allée dans ce pays une fois ! » (et sa variante : « J’adore le mafé ! »)
L’intention de cette phrase est de connecter avec l’autre, pour témoigner d’une part que nous avons une certaine ouverture d’esprit, et pour lui signifier d’autre part que nous avons des centres d’intérêts et/ou des goûts partagés. L’idée est de partir d’une « base commune » pour permettre de tisser du lien.
L’impact potentiel pour la personne qui reçoit ce message est encore une fois d’être ramenée à son « extériorité » et de donner le sentiment que l’on le perçoit à travers une vision trop réductrice de sa culture. Le mafé par exemple est un plat sénégalais et malien, qui a peu de chance d’évoquer une madeleine de Proust à un Gabonais ou à un Soudanais… Sans oublier que tous les Sénégalais n’aiment pas forcément le mafé !
Le bon réflexe : essayez de transposer à votre propre origine, par exemple régionale. Personnellement, je suis née et j’ai grandi en Picardie. Si en apprenant cette information, un collègue m’évoque ses supers souvenirs de son week-end en baie de Somme, cela ne me ferait ni chaud ni froid car en fait je viens de l’Oise et je n’ai jamais eu l’occasion d’admirer la richesse écologique de ce haut lieu ornithologique ! S’il me parlait du Liban en revanche, il verrait alors des étoiles briller dans mes yeux… Mais ce sujet n’a rien à voir avec mes origines ! Gardez donc en tête que le point de départ « origines » n’est pas toujours le plus pertinent pour créer du lien avec une personne.
« Vous pensez quoi à propos de… »
L’intention est d’intégrer l’avis de l’autre dans notre réflexion en accordant de la légitimité à ses propos. On a compris que la diversité de points de vue est une richesse, et que l’on ressort grandi quand on apprend à considérer des avis extérieurs au nôtre.
L’impact potentiel est de produire un certain agacement, car l’on n’a pas forcément envie de prendre la parole au nom de son groupe. Demander à une collègue marocaine « Est-ce que j’ai le droit de porter des babouches ou est-ce que c’est de l’appropriation culturelle ? » n’est pas tout à fait la même chose que de lui demander explicitement son avis personnel « qu’est-ce que tu penses de ça ? ».
Le bon réflexe : apprivoisez votre cerveau en comprenant que nous sommes toutes et tous sujets à un biais d’assimilation « intra-groupe ». Autrement dit, notre cerveau est fainéant et partant, est vite tenté de percevoir une ressemblance plus resserrée entre les membres d’un groupe que la réalité… Comprenez qu’il existe toute une diversité de points de vue et de personnalités au sein d’un même groupe, et que cela n’a pas beaucoup de sens de considérer « les femmes », « les hommes », « les séniors », « les asiatiques » ou encore « les marocains » comme un ensemble homogène et uniforme.
« Les métis sont super beaux »
L’intention de cette phrase est de valoriser la différence, d’autant plus que cette dernière est le produit de l’amour et de la diversité. Penser que « les métis sont l’avenir de l’humanité » revient peu ou prou à caresser l’espoir du triomphe de l’inclusion sur le rejet du « différent ».
L’impact potentiel pour la personne qui reçoit ce message est de ressentir le poids d’une forme de fétichisation ou de fantasme idéalisé autour du « mélange », perçu à l’extérieur comme quelque chose d’uniquement bénéfique. C’est ainsi faire déni d’un vécu en réalité un peu plus complexe pour les personnes concernées. « L’entre-deux » fait en effet souvent éprouver une plus grande difficulté à trouver une zone de confort identitaire. Il n’est pas évident de percevoir le mélange d’un bon œil quand on est sans cesse renvoyé à notre part de différent. Gaël Faye l’explique bien dans une de ses chansons : « le métis n’a pas sa place dans un monde dichotomique. Donc c’est dit, je suis noir dans ce pays, c’est pas moi qui l’ai voulu je l’ai vu dans le regard d’autrui ».
Le bon réflexe : reconnaître la différence est une (bonne) chose, mais y accoler un jugement – même positif – en est une autre. Essayez de ne pas véhiculer de charge émotionnelle dans la prise en compte du sujet des origines car en fonction de nos vécus, nous intégrons des émotions différentes.
« Black », « Renoi », « Rebeu »…
L’intention de ces termes est de parler des origines mais de manière détournée, en utilisant un vocabulaire plus socialement accepté que « noir » ou « arabe », pour montrer à travers une pirouette sémantique que l’on n’est pas raciste et que l’on a une vision progressiste du sujet.
L’impact potentiel pour la personne qui entend ces termes est – de manière contre-intuitive – de renforcer un sentiment de stigmatisation, comme si les mots « noir » et « arabe » étaient perçus dans la bouche de l’émetteur comme des gros mots. On ne dit pas « white » pour parler des blancs, alors pourquoi tant de réticence avec le mot noir ?
Le bon réflexe : comprendre que le problème n’est pas les mots que l’on utilise, mais les représentations accrochées à ces mots, autrement dit, les stéréotypes. Changer de vocabulaire sans faire évoluer nos stéréotypes n’a donc aucun intérêt ! Il est donc bien plus utile d’essayer d’identifier les stéréotypes négatifs que la société nous a logés dans la tête autour des différentes origines, pour ensuite tenter de les neutraliser au moment d’aborder le sujet. Si toutefois la syntaxe vous importe, vous pouvez garder à l’esprit que l’adjectif est préférable au nom (« un collègue arabe » plutôt qu’ « un arabe »), et que les noirs ne sont pas noirs mais plutôt « marrons ».
On ne peut vraiment plus rien dire ?
Bien sûr, penser que toutes ces phrases constituent de facto des micro-agressions et qu’elles seraient nécessairement vécues de manière problématique par tous nos collègues racisés reviendrait encore une fois à faire le jeu de notre biais d’assimilation intra-groupe. Voyons plutôt ces phrases comme des « facteurs de risque » à garder dans un coin de la tête mais autorisons-nous une marge de liberté pour adapter nos conversations dans l’intuitu personae.
Et si jamais vous réalisez que vous venez de commettre une maladresse, pas de panique ! Tout le monde peut blesser sans le vouloir, et il est utile ici de distinguer les auxiliaires être et avoir : ce n’est pas parce que l’on vous a remonté « avoir dit quelque chose de raciste » que cela signifie que « vous êtes racistes » ! Peu de gens sont convaincus par l’idéologie raciste de hiérarchie entre des races supposées (l’être), mais nous portons tous en nous des biais racistes (l’avoir), qui sont le produit de notre histoire, de notre société et des limites de notre cerveau. Ne vous offusquez donc pas dans ce cas, mais prenez ce feedback comme une opportunité de vous améliorer sur le sujet.
Des excuses exprimées simplement et avec sincérité et l’intégration de votre maladresse dans l’évolution de votre comportement seront toujours plus précieuses que mille déclarations d’intention… Peu importe nos origines réelles ou supposées, l’écoute, l’empathie bien dosée et l’humilité sont toujours des qualités appréciées !
Valentine Poisson