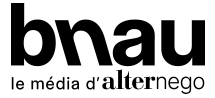La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est le produit de notre société : elle se fait le miroir permanent des grandes préoccupations de notre temps. C’est ainsi que la notion de RSE a considérablement évolué au cours des trente dernières années. En retraçant sommairement les grandes étapes des prises de conscience successives de l’entreprise quant à sa responsabilité directe et indirecte vis–à–vis de son environnement, trois grands mouvements semblent en effet se dégager.
Temps 1 : 1980, une approche avant tout environnementaliste
Il s’agit de l’éveil militant d’une partie de la société civile confrontée à des modifications manifestes de son écosystème du fait de l’activité de certaines organisations et de la succession de catastrophes écologiques impliquant directement des industriels. Aussi, les questions environnementales s’inscrivent progressivement dans les consciences humaines à la mesure des impacts que les activités humaines font peser sur la planète.

Ex : la marée noire causée en mars 1978 par l’Amoco Cadiz, supertanker qui s’échoua au large du Finistère-Nord.
Cette « première ère » de la Responsabilité Sociale des Entreprises donne naissance à un certain nombre de concepts comme « Développement Durable » ou encore « Transparence », notions aujourd’hui tout à fait intégrées dans le vocabulaire de l’entreprise. En effet, malgré une période de rejet, certains secteurs industriels tels que la production d’énergie, la sidérurgie ou la pétrochimie, n’ont pas d’autre choix aujourd’hui que d’adopter une attitude plus ouverte, notamment en vue d’améliorer leur image[1].
Temps 2 : 1990, une approche sociétale, en plus de la conscience environnementale
Environ dix ans plus tard, un mouvement plus sociétal apparaît et confronte cette fois-ci l’entreprise non pas à son environnement, mais à ceux qui le représente. Au-delà des impacts générés par son activité, l’organisation est désormais tenue de rendre des comptes à des personnes extérieures à son propre système.
Elle se voit donc dans l’obligation de prendre en compte les « parties prenantes », membres de l’écosystème social de l’entreprise qui transforme progressivement sa conception de la gouvernance.
Puisque « la réputation d’une organisation est issue de l’assemblage de toutes les images qui se sont construites au fur et à mesure du temps auprès des différents publics[2] », cette dernière intègre dans ses décisions et ses actions non plus ses seuls actionnaires, mais aussi une multitude d’acteurs susceptibles de l’impacter : concurrents, fournisseurs, défenseurs des consommateurs, médias, écologistes, gouvernements, etc. En effet, les contestations portées par ces parties-prenantes sont d’autant plus virulentes et médiatisées que les pratiques des firmes, notamment multinationales, sont jugées irresponsables et non-éthiques.
Exemples :
- Nike (1990) fait l’objet de vives critiques relatives aux conditions de travail des ouvriers de ses usines sous-traitantes. Le travail des enfants, les politiques de rémunération, les licenciements massifs à l’œuvre sont largement dénoncés par de nombreuses contre-publicités, sites internet, reportages télévisés et radiodiffusés, articles de presse, et notamment dans un documentaire réalisé en 1998 par Michael Moore intitulé « The Big One ».
- Une association lance les « Public Eye Awards » (2000) forme de contre-manifestation destinée à étiqueter les organisations les plus irresponsables sur le plan humain et environnemental. Cette campagne bénéficie d’une importante couverture médiatique de portée internationale : Shell, Wal-Mart, Areva, Chevron ou encore Bridgestone ont ainsi déjà été épinglés par ce « prix de la honte ».

Le déluge normatif qui a accompagné l’ensemble de ces évolutions a permis de faire glisser graduellement le concept RSE de coquetterie vers une contrainte réelle, objectivable et encadrée. À titre d’exemple, quand en 1977 moins de 50% des compagnies du classement Fortune 500 évoquaient la RSE dans leurs rapports annuels, elles sont plus de 90% à le faire à la fin des années 1990.
En France, la mondialisation et son lot de transformations permanentes ont ouvert la voie à de nouvelles façons de concevoir la RSE. D’une conscience plus aiguë de son environnement direct et indirect, l’entreprise a été soumise en moins de vingt ans à une crise de conscience sans précédent, et n’a d’ailleurs pas encore fini de réinventer ses modèles.
Temps 3 : 2000, impact identitaire et RSE 3.0
L’émergence de la question identitaire dans le travail a considérablement repositionné la notion de RSE. En effet, nous assistons à un 3e mouvement, une forme de RSE 3.0 inhérente aux modifications de l’organisation du travail.
En effet, la question identitaire, initialement à peine considérée, est devenue un sujet d’étude majeur en à peine quinze ans, du fait des profondes mutations économiques et technologiques que nous traversons, mais également des spécificités dans la façon dont les grandes transformations sont menées, à l’instar de l’éloignement entre les centres de décisions et les strates plus opérationnelles de l’organisation.
La psychologue et psychanalyste Marie Pezé, auteure de la première consultation « Souffrance et Travail » à Nanterre en 1997 déclarait : « Je n’aurais sans doute jamais perçu la « centralité » du travail dans la construction identitaire si les pathologies sociales n’étaient entrées en force dans cette salle de consultation aux côtés des pathologies dont j’avais l’expérience ». Aussi, c’est bien le prisme identitaire qui occasionne le plus de souffrance au travail, du fait de son retentissement sur le corps et le psychisme. À l’origine du risque psychosocial se trouve une identité durablement atteinte, au point d’en souffrir de manière intense et continue.
Le travail comporte donc une puissante composante affective et subjective. On serait donc tenté d’évoquer une troisième révolution de la RSE, cette fois directement liée au débat relatif à l’organisation du travail elle–même. En effet, si les méthodes de gestion, de management et d’organisation du travail aspirent à rationaliser le travail et la performance accomplis, « l’investigation clinique du travail suggère qu’une part essentielle de l’activité humaine relève de processus qui ne sont pas observables et résistent donc à toute évaluation objective », comme le confirme Christophe Dejours. Aussi précis que puissent être les standards d’une activité, le travail réalisé ne saurait se résumer à la simple exécution des tâches prescrites.
Grâce à ce débat, les entreprises sont donc invitées à prendre la mesure de leur responsabilité à travers une interrogation introspective sur ce qui, dans nos modes de fonctionnement, peut se révéler violent pour le travailleur.
Cela implique notamment de :
- Responsabiliser les centres de prescriptions où sont décidées les grandes orientations stratégiques à l’origine de la refonte des organisations du travail.
- Redonner un pouvoir réel aux opérateurs, qui, tout au bout de la chaîne, mesurent quotidiennement les décalages entre ce qui est prescrit et ce qui est réel.
C’est ce que défend Yves Clot, lorsqu’il affirme que « la souffrance n’est pas d’abord le résultat de l’activité réalisée. C’est ce qui ne peut pas être fait qui entame le plus. La souffrance trouve son origine dans les activités empêchées, qui ne cessent pourtant pas d’agir entre les travailleurs et en chacun d’eux sous prétexte qu’elles sont réduites au silence dans l’organisation ».
C’est pourquoi, la RSE est aujourd’hui indissociablement liée au bien faire.
En ce sens, la RSE devient étroitement corrélée à la nature de la conflictualité au sein de l’organisation. En effet, selon Michel Crozier le management à la française se caractérise par la fuite face aux conflits et l’évitement face aux situations difficiles. Il est symptomatique de constater[3] que « parmi les salariés du secteur concurrentiel qui ont connu des changements organisationnels ou technologiques importants au cours des trois dernières années, 64 % estiment ne pas avoir été consultés lors de la mise en place de ces changements ». Décider de ce que le travail doit être à la place des autres, sans associer les personnes concernées, et pratiquer la politique de la chaise vide face à l’expression du désaccord, aboutissent à un impact désastreux sur la motivation et la santé au travail.
Ainsi, pour le bien-être de ses salariés et pour sa propre efficacité, une préoccupation majeure de l’organisation tient donc aujourd’hui de l’instauration d’un climat propice à des relations de travail pacifiées.
Face au conflit, deux options sont couramment admises :
- Le conflit n’est pas géré (on retrouve la stratégie de l’évitement et autres politiques dites de « l’autruche ») ;
- Le conflit est mal géré, et conduit à des rapports de domination/soumission, faisant peser le risque d’une escalade conflictuelle, jusqu’à la destruction de la relation.
Le danger à ne pas prendre en main les conflits est donc réel et le conflit est donc souvent perçu comme destructeur. Ceux-ci peuvent en effet se transformer en agressivité puis en violence contre les autres ou contre soi-même.
Pourtant, sans conflit, aucune friction n’est possible pour libérer les énergies nécessaires à la mesure de l’impact des stratégies, décisions ou comportements de l’organisation.
Une troisième approche propose donc de considérer le conflit, s’il est bien géré, comme un vecteur positif qui tient un rôle essentiel dans les organisations, puisqu’en provoquant la confrontation des points de vue, il permet les transitions, évolutions et améliorations. Une conflictualité productive est donc indispensable à l’organisation apprenante.
Pour développer une culture du conflit productif, les entreprises peuvent mettre en place toute une série de dispositifs, focalisés sur les individus et/ou sur l’organisation, qui reposent sur la recherche d’une satisfaction des intérêts et des valeurs de toutes les parties prenantes de l’organisation, à travers l’identification des enjeux de chacun et des solutions créatives et légitimes à même de les satisfaire.
Il s’agit donc de prendre en compte la diversité de l’entreprise avec une posture inclusive, et par la même de rétablir de la communication et le lien au sein de l’organisation. La négociation est le processus d’excellence à cette fin, mais lorsque le désaccord prévaut entre les parties, la médiation représente, à travers l’intervention d’un tiers, l’outil le plus adéquat pour aider à satisfaire les intérêts des individus en conflit. En effet, la médiation, qui responsabilise les protagonistes en les amenant à trouver la solution par eux-mêmes, permet de résoudre des conflits plus rapidement que par la voie judiciaire, et à moindre frais. Dans cette approche, l’homme reste au centre des processus, ces derniers étant focalisés sur la compréhension et les interactions entre les individus.
Lorsque la négociation entre les acteurs en conflit ne fonctionne pas, ce qui n’a rien d’exceptionnel à la vue de toute la complexité que peuvent revêtir les dynamiques conflictuelles, il s’agit de leur permettre de se sentir soutenus par l’organisation grâce aux nombreuses ressources internes (délégués du personnel, médecins du travail, correspondants RH, personnes de confiance, commissions de harcèlement…) ou externes (assistances d’aide aux victimes ou des médiateurs) mises à disposition des salariés et fonctionnaires pour leur offrir l’écoute et l’accompagnement nécessaires.
L’ensemble de ces différents dispositifs constituent un tout supérieur à la somme de ses parties, ce qui dénote l’importance d’avoir un système de gestion de conflits internes ou protocole relationnel clairement défini, qui respecte certains principes essentiels comme l’impartialité des tiers ou de la protection des droits collectifs.
Dans l’idéal, l’approche se doit également d’être graduelle, fluide et évolutive d’une part, et doit reposer sur sa capacité à être à la fois responsable et responsabilisante pour ses parties-prenantes d’autre part.
Pour en assurer le succès, la culture de l’entreprise est essentielle. Pour mettre en place des processus facilitant la gestion des hommes en amont des projets plutôt qu’en aval des crises, il est en effet primordial de favoriser l’instauration d’un état d’esprit fondé sur la coopération et sur le respect.
La RSE 3.0 représente par conséquent un recentrage sur l’activité elle-même, le travail et ce qu’il dit de celui qui l’effectue, ce qu’il dit du degré de maturité de l’entreprise sur les grands enjeux soulevés par les profondes transformations que nous vivons depuis près de 20 ans. La RSE 3.0 pose fondamentalement le principe suivant : « remettre l’homme dans une position reconnue de sujet capable par son libre arbitre et son professionnalisme d’apporter une juste contribution au collectif de travail au sein duquel il gagne ses lettres de noblesses, sa respectabilité et sa dignité ».
L’évolution de la RSE est en somme partie de l’extérieur vers l’intérieur de l’entreprise, de l’environnement vers les Hommes, avec d’abord une approche environnementale, puis sociale. C’est avant tout une question de cohérence, si l’entreprise n’a pas d’abord à cœur de prendre soin de ses collaborateurs, il lui apparaîtra inexorablement difficile, voire impossible, de porter une relation positive vers l’extérieur et des valeurs qu’elle ne retrouve pas en interne.
Philippe Émont & Ricardo Pérez Nückel
[1] Ekman, 1998 ; Lefèvre, 2006.
[2] Fombrun, 1996, cité par Binninger & Robert, 2011
[3] Selon l’enquête Changement Organisationnel et Informatisation (COI) de 2007 citée par Thomas COUTROT et Catherine MERMILLOD, ibidem, décembre 2010.