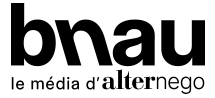Longtemps, le sujet des violences conjugales n’a pas été considéré par les entreprises comme relevant de leur champ d’actions en faveur de l’égalité de genre et des droits des femmes.
Aujourd’hui, la problématique intègre les politiques sociales et/ou de diversité, équité & inclusion (DE&I) et/ou de prévention des risques psychosociaux d’un nombre croissant de sociétés. Pourquoi cette nouvelle attention aux violences conjugales ? Comment les entreprises s’emparent-elles du sujet ? Peuvent-elles faire plus (ou mieux) ?
« L’intime est politique »
Pour comprendre l’attention nouvelle des entreprises aux violences conjugales, il faut commencer par observer une croissance manifeste de cette préoccupation dans l’ensemble de la société.
L’historienne Victoria Vanneau, autrice du remarquable essai La paix des ménages – Histoire des violences conjugales XIXè-XXIè siècle (Anamosa, 2016), montre comme les législateurs, les tribunaux, la presse, les écrivains et les institutions ont longtemps œuvré à inscrire ces violences dans le registre des faits divers (et de la jurisprudence) et non du fait de société (et du droit). La domination de la femme par l’homme dans les foyers était alors considérée comme un problème d’ordre privé et seuls les « excès » en étaient condamnés. Par excès, comprenez les agissements donnant lieu à des accidents graves, des décès. Comme si la violence conjugale était une suite de faits marginaux, explicables par des circonstances individuelles, des personnalités singulières, des relations dysfonctionnelles à la complexité inaccessible. Cela aura favorisé le brossage du portrait-type du conjoint violent en « cas social » déviant et l’infusion dans les esprits d’un imaginaire de la violence conjugale comme un fait de misère.
Depuis une quarantaine d’années, on a largement documenté le sujet pour établir que la violence conjugale concerne tous les milieux sociaux et ne se limite pas aux cas psychiatriques les plus facilement identifiables. Autrement dit, Monsieur ou Madame Tout le Monde peut être un·e agresseur·euse domestique, y compris votre employé·e très bien noté·e.
La littérature en sciences sociales s’est considérablement enrichie, diffusant des concepts robustes tels que ceux d’emprise, de contrôle coercitif, de violences économiques… La notion de féminicide s’est installée en remplacement bienvenu des scabreux « crime passionnel », « drame familial » et autres « crise de couple qui tourne mal ». Le slogan féministe « l’intime est politique » s’impose.
Les entreprises qui font partie de la société sont forcément concernées par de telles évolutions. De là à en faire un objet intégré à leur responsabilité sociale ?
La bascule du Covid
On peut dater la massification de l’intérêt des entreprises pour les violences conjugales à la période du Covid-19.
Une question inédite se pose alors aux employeurs dont les employé·e sont d’office en télétravail : quelle responsabilité en termes de sécurité physique et psychique quand le lieu de travail et le domicile des salarié·es se confondent sans qu’il y ait de possibilité de s’échapper ? Pris entre obligation de sécurité et devoir de ne pas porter atteinte à la vie privée, comme le signale dès avril 2020 la juriste Karine Mignon-Louvet dans un dossier de Liaisons sociales, les employeurs tâtonnent un peu… Et s’en remettent à l’obligation civile de porter assistance à une personne en danger quand ils sont informés des situations. Dans cette période où tout est plus complexe en raison de la distanciation sociale, ils s’appuient alors comme ils peuvent sur les tiers que sont la médecine du travail, les services d’assistance sociale intégrés…
En miroir, la question des agresseur·euses se pose aussi aux employeurs : faudra-t-il sanctionner un·e salarié·e qui, sur son lieu de travail (quand bien même ce serait son domicile) harcèle psychologiquement et/ou sexuellement une personne ou bien lui porte des coups ? La question est vite répondue si victime comme agresseur sont salarié·es de la même entreprise. Mais si la victime n’est pas dans les effectifs de l’employeur, faut-il la considérer comme une partie prenante à l’équivalent d’un client, d’un partenaire, d’un fournisseur ; et en ce cas, sanctionner le/le salarié·e qui lui aura porté préjudice ?
Sans réponses définitives à leur question, les entreprises sentent qu’elles n’ont cependant plus le choix : elles sont obligées de s’emparer du sujet des violences conjugales.
La rhétorique des coûts
Mal à l’aise avec le sujet et peu aidées par un cadre légal ambigu (contrairement au Canada qui révise dès 2022 sa Loi sur la santé et la sécurité au travail pour intégrer formellement des obligations des employeurs en matière de prévention et traitement des violences conjugales), les entreprise françaises ont le premier (bon) réflexe de partager le questionnement et d’échanger sur les pratiques dans les instances dédiées aux risques professionnels (les syndicats s’emparent du sujet, l’ANDRH lance un groupe de travail qui va rapidement aboutir à des publications dédiées) et avec leurs partenaires experts (après l’AVFT qui publie depuis la fin des années 2000 un guide dédié, la Fondation des Femmes va éditer le sien tout comme la fondation FACE ).
Parallèlement, des discours se formalisent pour asseoir la légitimité des entreprises à prendre la parole sur le thème des violences conjugales et à prendre des actes pour lutter contre le fléau. La voie la plus simple apparait alors celle de la mesure du coût économique sur lesquelles les entreprises semblent fondées à s’exprimer, puisqu’on dit que la (contre)-performance chiffrée est leur première langue. L’idée n’est pas neuve : dès les années 1990, des épidémiologistes et des économistes de la santé objectivent le poids du fardeau des violences commises au sein des couples sur la comptabilité nationale (entre 3 milliards et 60 milliards d’euros pour la France selon les méthodes de calcul). C’est d’ailleurs sur cette logique de réduction des coûts évitables que se fonderont les négociations autour de la Convention d’Istanbul de 2014.
Si cette approche a la vertu de donner de bonnes raisons à l’entreprise de faire sienne la question de la violence conjugale, elle a le défaut de laisser en creux l’idée que des violences non coûteuses pourraient être plus tolérables. La question est un peu rhétorique car il n’existe pas vraiment de violences sans conséquences pécuniaires, directement ou indirectement. Toutefois, l’angle de la charge financière heurte certains acteurs qui lui préfèreraient sensiblement celui des principes de justice, de sécurité, d’égalité.
Ce que « tolérance zéro » veut dire
Quand elles sont interpelées sur des sujets qui les dépassent en raison de ramifications complexes au-delà du seul cadre du travail, les entreprises sont parfois tentées de répondre par des déclarations de principe très fermes. Ainsi, la notion de « tolérance zéro » s’invite volontiers quand il est question de condamner les violences.
Mais cela est-il efficace pour les prévenir et les traiter ? Il faut rappeler avant toute chose que la doctrine « tolérance zéro » vient des discours américains de politiques de sécurité intérieure des années 1980. Cette doctrine repose sur deux idées fortes : premièrement, il n’y a pas de petit délit mais toute incivilité est le début d’un continuum amenant à la délinquance la plus mortifère ; deuxièmement, la fermeté a le pouvoir de créer de l’exemplarité. Autrement dit punir sévèrement un contrevenant, c’est avertir tous ceux qui seraient tentés de sortir des rails que ça va leur coûter cher et donc les décourager de commettre des méfaits.
Est-ce que cela marche en général ? Plutôt non. Cela peut favoriser un sentiment de sécurité chez une partie de la population que rassure la fermeté, mais cela ne crée pas nécessairement un surcroît de sécurité réelle. Pire : cela produit des réactions préventives chez les personnes malintentionnées qui ne renoncent pas à leurs agissements mais travaillent activement à ce que ceux-ci ne se sachent pas : destruction de preuves, intimidation des victimes, blanchiment de leur réputation…
Sachant ce que donne la « tolérance zéro » en général, il y a de quoi douter de son application sur le terrain des violences conjugales. La personne qui s’y livre pourrait bien être tentée de faire (encore plus) taire sa victime et de déployer une grande énergie pour à passer le plus possible pour quelqu’un d’insoupçonnable, voire quelqu’un de formidable !
L’entreprise comme cadre d’apprentissage
Encore faut-il que notre agresseur·euse domestique se sente visé·e. Car la plupart des personnes qui commettent ce type de violences n’en ont pas conscience et/ou en nient la qualification. Reconnaître la personne violente en soi, ce n’est pas évident !
Cela l’est encore moins quand on évolue dans des environnements qui valorisent l’agressivité, encouragent la domination, entretiennent le sentiment de supériorité. En termes plus directs, peut-on vraiment en tant qu’employeur prôner les comportements respectueux chez les individus quand, en tant qu’entreprise, on considère la concurrence comme des ennemis, la conquête de parts de marché comme une guerre et ses employé·es comme des soldats que l’on récompense quand ils œuvrent à l’hégémonie de l’entreprise ? Peut-on vraiment réduire l’intolérance à la frustration des individus quand on les met systémiquement sous pression temporelle dans le travail ? Peut-on vraiment les enjoindre au dialogue en cas de tensions si le vécu qu’ils/elles ont de la confrontation professionnelle relève plus du rapport de force que de la disputatio ouverte ?
L’entreprise a bien une fonction éducative en matière de comportements sociaux. Elle est un cadre d’apprentissage des codes à travers les interactions, contenues par la régulation. L’entreprise est donc tout à fait fondée à s’emparer de la question des violences qui se situent en dehors de ses portes. Mais elle ne peut assurer efficacement ce rôle que si elle ne rompt elle-même avec la violence qui hélas, caractérise bien souvent les dynamiques économiques. Les travaux sur la culture de paix économique soutenus par le pacte mondial de l’ONU constituent alors une bonne source d’inspiration pour concevoir et déployer des politiques de réduction de la violence des entreprises dont on peut attendre qu’elles portent leurs effets sur les comportements de celles et ceux qui évoluent (entre autres) en entreprise.
Et les politiques d’égalité femmes/hommes dans tout ça ?
Reste un paramètre essentiel à prendre en compte quand on adresse la problématique des violences conjugales : leur caractère genré. Nous adressons le sujet depuis le début de cet article dans une langue inclusive qui d’une part porte l’intention d’une forme d’universalité de la réponse, et d’autre part témoigne de la prise en compte des 13% d’hommes qui sont victimes de violences conjugales. Mais les 87% de femmes parmi les victimes obligent à une corrélation avec les inégalités de genre. Les expert·es n’ont pas de difficultés à déterminer une causalité : parmi les nombreuses contributions allant dans ce sens, les travaux de l’historienne Christelle Teraud, autrice de Féminicides – Une histoire mondiale (La Découverte, 2022) mettent bien en évidence de quelle façon une organisation sociale patriarcale (c’est-à-dire ce qui s’observe sur la majorité de la planète à l’heure actuelle, France comprise) favorise le contrôle des femmes, l’appropriation de leur liberté et l’exercice de la violence à leur encontre.
Il faut aussi, très pragmatiquement, observer les effets des inégalités de genre sur les moyens qu’ont les femmes d’échapper à la violence dans les foyers. La littérature romanesque et le discours médiatique mettent volontiers l’accent sur les mécanismes d’emprise qui aveuglent les femmes sur leur condition et les retiennent auprès de leurs agresseurs intimes. Cela existe, assurément, et compte. Mais la prééminence de cette lecture psychologique pourrait parfois faire oublier que la première des réponses à la question « mais pourquoi ne partent-elles pas » se situent du côté très matériel de leur condition économique. Avant toute chose, ce qui empêche les femmes de quitter un conjoint violent, c’est le déficit de moyens financiers le leur permettant (en attendant le coût des séparations dont il est rigoureusement objectivé qu’elles défavorisent nettement les femmes sur le plan économique).
Il y a là un levier sur lequel les entreprises ont clairement la main, si elles veulent s’engager sur le terrain de la lutte contre les violences faites aux femmes : favoriser leur pleine et réelle autonomie financière en effaçant les inégalités salariales. Pas seulement les inégalités « inexpliquées », qui sont encore manifestes quoique réduites aujourd’hui à un peu moins de 4%. Mais l’écart global (de plus de 22% à l’heure actuelle) qui repose sur le manteau profond de notre géologie sociale où se situe la division sexuée du travail et l’ancrage des perceptions collectives de la performance.
À ce compte, on peut espérer que le souci nouveau qu’ont les entreprises de s’engager contre les violences conjugales amorce de vraies démarches d’innovation sociale…
Marie Donzel
Directrice associée