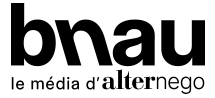Les entreprises ont eu de plus en plus recours à la médiation ces dernières années. Et pour cause, l’acceptation de l’existence du conflit, de la tension au sein du travail est passée d’un enjeu qui décrivait un dysfonctionnement, à une donnée des relations au travail. Alors comment expliquer cette évolution ? Et comment appréhender son impact sur les organisations ? Décryptage avec Florence Duret Salzer, médiatrice et co autrice de « La médiation au travail », aux côtés de Jean-Edouard Grésy et Cristina Kuri.
Le développement de la médiation en entreprise
La question du conflit dans les organisations n’est plus un tabou, et la législation est là pour nous le confirmer. En atteste l’arrêt du 25 novembre 2015, de la Cour de cassation qui change clairement de logique dans l’appréciation de l’obligation de sécurité de l’employeur.
En effet, elle affirme, dans un attendu de principe, que « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ».
Malgré la survenance du résultat, l’employeur peut échapper à la condamnation au motif qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié. La médiation, comme d’autres dispositifs visant la sécurité des salariés, prend ainsi tout son sens.
On bascule alors d’une obligation de sécurité de résultat, à une obligation de moyens, puisque ce cadre légal veut soutenir la mise en place de la médiation comme étant une mise en œuvre de cette obligation renforcée.
Il convient toutefois de nuancer ce basculement dans la mesure où c’est une obligation de moyens « renforcée » car l’employeur doit prouver qu’il a bien mis en œuvre les mesures nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés.
L’évolution du rapport au travail
De plus, l’évolution du vécu au travail amène à un constat : l’individu vient chercher au travail la considération de sa personne, au-delà de sa compétence, au-delà du collectif. Au travail, le professionnel veut être valorisé pour l’individu qu’il est avant sa capacité à faire grandir l’organisation. Chacun cherche à être considéré dans son individualité avant sa participation à la productivité. De fait, la question de la relation prime sur toutes autres actions.
La Relation, la Reconnaissance, le Respect sont le préalable pour favoriser la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT). Et dans le cas où un de ces « 3R » est touché, la coopération est mise à mal par le conflit induit. D’où le développement de la médiation pour tenter de recréer les conditions de la coopération qui prime pour que chacun donne du sens à son travail.
La médiation : sa place dans l’organisation
Néanmoins, ce n’est pas parce que la médiation se développe que son usage doit être un réflexe. Car si cette dernière a une place dans l’organisation en tant que facilitateur des relations, cela serait démunir les salariés que de la poser comme un incontournable à chaque tension.
Ainsi, avant de solliciter ce processus, il est important d’interroger une démarche responsable favorisant un dialogue direct entre les parties afin qu’elles trouvent par elles-mêmes la solution à leur différend. La médiation intervient quand cette tentative n’a pas abouti, quand le face à face est sans issue alors que l’interdépendance demeure. La médiation ayant une obligation de moyen et non de résultat, en cas d’absence d’accord, un passage de relais est nécessaire pour choisir une solution RH (coaching, formation, enquête, décision hiérarchique, recadrage disciplinaire…)
L’idée est de favoriser une tentative amiable pour les personnes par la mise en place de la médiation, pour répondre à leur besoin de retrouver sérénité et sécurité psychologique dans leur manière d’interagir entre elles.
La médiation peut être proposée et non imposée. La libre adhésion est un ingrédient de son fonctionnement. Les 3 temps (dialogue direct/médiation/solution RH) sont nécessaires pour l’efficacité d’un tel dispositif. L’organisation a la mission d’assurer sa continuité en cas de blocage persistant, même si cela représente un nombre de situations infinitésimale.
La médiation : un recours en hausse sur différents formats et organisation
L’essor de la médiation en entreprise s‘accompagne aussi d’un développement de ses champs d’action. On ne parle plus seulement de son action “curative” mais aussi de sa capacité à prévenir les conflits. La médiation recouvre ainsi différents formats :
- En prévention, en médiation de projet : Un contexte qui implique de nombreux changements peut induire des tensions qui impliquent de proposer des cadres de compréhension pour favoriser les transformations (fusion, réorganisation, conduite de projets, …) La médiation de projet est à considérer comme levier structurant, permettant d’anticiper le « bien comprendre et décider ensemble » dans un projet complexe.
- En curatif, la médiation se développe : pour accompagner la compréhension autour des différends dans un contexte où il y a des « frottements » dans une équipe, ce qui implique un besoin de voir comment favoriser le retour de la coopération.
La médiation curative connait 3 formats principaux :
- En interne : compte tenu du cadre légal qui la prévoit, les personnes en charge de la QVCT développent de plus en plus des dispositifs de médiation interne. Ces dispositifs impliquent la formation de salariés volontaires au sein de l’entreprise. L’avantage : le développement d’une culture de la saine disputation et la mobilisation de tous comme insufflant l’idée d’une préoccupation collective.
- En externe : par sollicitation d’un cabinet extérieur. L’avantage : le recours externe par un médiateur professionnel favorise le partage des vécus, surtout en cas de tensions interpersonnelles fortes. Elle est souvent préférable quand les parties en conflits ont des postures hiérarchiques hautes dans l’organigramme.
- En hybride : Il est possible de proposer de la co-médiation associant les avantages du médiateur interne et externe.
La médiation : curative ou préventive implique des processus adaptés :
- Médiation bipartite : entre deux personnes
- Médiation collective : pouvant concerner un service entier, par exemple.
La méthode est la même dans les deux cas. Le nombre implique des processus adaptés à chaque situation.
D’années en années, ces différents formats prennent de l’essor. Si la médiation curative a fait un bond en avant dans les cultures des organisations, la médiation de projet est en train de commencer son développement.
Par exemple dans le cadre de nombreuses médiations dans le cadre de retour d’arrêts longue maladie. Les organisations ne sont pas toujours à l’aise pour prendre le temps de penser le retour. Celui-ci peut être un frein à la reprise dans certains cas où les questions de relations sont en jeu. Cela favorise alors la reconduction de l’arrêt.
La médiation s’avère être un processus favorable à la reprise, en assurant la qualité d’un retour du fait de ce qu’elle induit : la reprise de la communication en assurant que personne ne perde la face, et que chacun retrouve sa juste place
Quels défis pour le développement de la médiation en entreprise ?
Le développement est clair : la médiation est un processus qui permet à l’organisation mature de prendre en compte le conflit comme une donnée à considérer et non comme à enjeu à combattre.
Ceci étant dit, la médiation doit veiller à bien se placer dans son rôle sans se substituer à d’autres rôles internes : elle a pour vocation un accompagnement ponctuel pour soutenir le management vers la coopération, ou la fonction RH dans son obligation de moyen renforcé, ou la mission de veille des OS dans leur mandat de protection.
Elle ne substitue aucunement aux rôles internes qui ont des fonctions de régulation des
tensions. Elle accompagne ponctuellement en soutien de situations de blocage
nécessitant un recul, un pas de côté dans un cadre de sécurité, pour laisser la place à une reprise d’autonomie des individus : dans leur équipe, dans leur organisation, dans leur système. Telle est la mission de ce dispositif : passer pour disparaître.
Florence Duret-Salzer