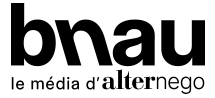À rebours de la vision commune qui associe conflit et violence ou encore conflit et blocage, plusieurs courants philosophiques le définissent comme un moteur du devenir, un lieu de potentialités, « le père de toutes choses ». Inhérent donc à la nature humaine. Moteur de changement nous disait Héraclite. Alors comment appréhender le conflit différemment ? Décryptage avec notre philosophe Sophie Berlioz.
Que nous dit la philosophie du conflit ?
Sophie Berlioz : On retrouve une connotation productive et éminemment social du conflit au cœur de la sociologie formelle de G. Simmel. Pour le philosophe allemand, le conflit constitue une (si ce n’est LA) dimension fondamentale de la vie collective. Ainsi, loin de s’opposer à l’association, il en est l’une des principales modalités : il crée du lien, produit de la reconnaissance et fonde ainsi la dynamique de groupe au sein de la triade, forme élémentaire du collectif. En effet, chez Simmel, dès lors qu’un 3ème acteur entre dans une relation dyadique, il rend possible des oppositions, des alliances, ou encore des médiations. Soit autant de mécanismes sociaux qui ne peuvent se déployer au sein des dyades. Dit autrement, la reconnaissance mutuelle et les structures sociales naissent du conflit. Il y a donc en philosophie une dimension structurante du conflit, inhérente à la forme la plus élémentaire du social, et par extension, génératrice d’une dynamique constitutive de l’affirmation d’un sujet, d’un groupe ou encore d’une société.
Quels bénéfices peut-on tirer de cette approche ?
SB : J’en vois au moins deux. Le premier bénéfice si l’on suit Simmel ce serait de considérer que le conflit est un moyen de maintenir une unité sociale en intégrant les différences plutôt qu’en les étouffant. Les désaccords entre individus n’excluent pas, comme on peut souvent le craindre. Au contraire ils peuvent renforcer les liens sociaux en incitant les parties à se reconnaître mutuellement, négocier, ou plus simplement interagir.
Le second, sur lequel Simmel est d’ailleurs souvent cité, serait de considérer le conflit comme une source d’innovation en ce qu’il obligerait les acteurs à questionner les routines, à traquer les présupposés ou encore à faire évoluer les pratiques dans les recherches de solutions et de compromis.
Comment les entreprises peuvent-elles s’en emparer elles aussi ?
SB : Le principal apprentissage pour les organisations serait donc de ne plus chercher à mettre les tensions sous le tapis, mais à mieux les gérer et les canaliser pour en faire des opportunités de développement, de régulation et de consolidation du lien social. Et cette transformation repose sur trois piliers concrets.
Premièrement, le développement des compétences des acteurs clés est fondamental. Et pour cause, il est crucial de renforcer la ligne managériale et les partenaires sociaux en matière de régulation et de négociation, et pourquoi pas aussi, de philosophie.
Deuxièmement, il est nécessaire de structurer des espaces de confrontation. Comme l’illustre la triade de Simmel, introduire un « tiers » permet de transformer une dualité stérile en une dynamique créatrice. Ceci peut passer par la formalisation d’espaces de médiation interne ou externe qui garantissent que la tension est non seulement accueillie, mais prise en considération et traitée.
Enfin, il y a un enjeu majeur à ancrer la reconnaissance du conflit dans la culture de l’organisation. Il ne suffit pas de tolérer le désaccord ; il faut le valoriser comme l’expression naturelle d’une diversité d’opinions et d’intérêts légitimes. Cela permet, in fine, de faire du conflit un véritable levier de performance collective et d’innovation, et non plus un simple frein à éviter à tout prix.