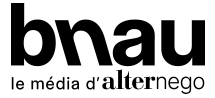Le voyage, c’est par définition l’évasion, la découverte de cultures et d’horizons nouveaux. Pourtant, il est aussi le reflet de nos excès : nous sommes passés de l’expérience à la consommation de masse, générant des impacts négatifs pour l’environnement et nos sociétés.
En réaction, une tendance forte émerge : la relocalisation du voyage. Alors que le tourisme mondial a retrouvé ses niveaux d’avant-COVID, le coût de cette « liberté » va s’envoler, limitant inévitablement les destinations lointaines dans les années à venir. Que signifie concrètement cette relocalisation pour nos futurs voyages ? Décryptage avec l’économiste Arnaud Florentin.
Comment expliquer le mouvement de relocalisation autour du voyage ?
Arnaud Florentin : Plusieurs facteurs sont à l’origine de ce mouvement. On compte par exemple l’enjeu majeur de saturation. Avec l’overtourism que subissent de nombreuses villes comme Venise ou Barcelone, les habitants réclament désormais un tourisme plus respectueux, doté de plus de régulation, de limitation. D’autant plus que l’argent dépensé par les touristes ne profite pas toujours pleinement aux territoires, créant un effet « seau percé ». Par ailleurs, les préoccupations environnementales, combinées à des mesures réglementaires et fiscales, influencent de plus en plus les choix de voyage. La réduction des vols intérieurs (en France) et la perspective d’une augmentation des coûts des voyages aériens incitent à privilégier des destinations plus proches et des modes de transport plus durables, comme le train.
Mais ce n’est pas tout, la géopolitique joue aussi un rôle dans l’émergence du mouvement. Et pour cause, les conflits, tensions diplomatiques et le terrorisme fragilisent de nombreuses destinations, restreignant les flux et incitant les gens à voyager plus près. Enfin, l’inflation à venir rendra le tourisme local plus accessible.
Face à ces différents aléas, les tendances comme le slow tourisme, les micro-aventures, les courts séjours et la redécouverte des patrimoines locaux sont en croissance. Bien qu’elles soient encore non majoritaires, ces dernières vont être amenées à se développer, favorisant les séjours plus courts, l’économie locale… Et c’est tout le tourisme local qui va alors être repenséer.
Comment s’adapter au mieux pour favoriser ce mouvement de relocalisation ?
Arnaud Florentin : Le tourisme est une immersion dans la culture, or la culture évolue constamment. Il est essentiel de commencer par redéfinir le patrimoine car contrairement aux idées reçues, le tourisme local ne se limite pas au passé. Il englobe toutes les formes de patrimoine et compte autant de possibilités de récits pour les raconter. Industriel, gastronomique, musical… Tous les actifs immatériels, qui n’existaient pas il y a 10, 20 ou 30 ans, sont aujourd’hui un moteur de croissance important du marché touristique.
Par exemple, si vous allez deux jours faire la fête à Ibiza, on parle de tourisme patrimonial, car un véritable patrimoine musical s’y est créé. Je pense aussi aux Eurockéennes de Belfort qui génèrent un impact économique notoire et représentent un patrimoine local nouveau. Cela nous raconte bien qu’il faut ouvrir la notion de « touriste » à quelqu’un qui vient vivre une expérience dans un territoire donné, même proche. Il y aura toujours des agences de voyages pour vendre des clichés et du dépaysement, mais je crois énormément à la création de ces micro-expériences, micro-aventures, micro-séjours dans lesquels chacun pourra trouver l’expérience qui lui convient. C’est ça l’avenir.
En quoi cette relocalisation du voyage va-t-elle aussi servir le territoire dans sa globalité ?
Arnaud Florentin : En effet, la relocalisation du tourisme ne se limite pas à attirer des visiteurs de proximité et à proposer des expériences aux habitants. Car si la notion même de voyage évolue, c’est aussi le cas du lien qui unit les acteurs touristiques à leur territoire. Auparavant, les acteurs étaient localement présents sans pour autant exploiter pleinement le territoire comme un véritable atout. Aujourd’hui, on observe une dynamique nouvelle : de plus en plus de réflexions émergent autour des approvisionnements locaux des hôtels et sites touristiques (alimentation, souvenirs, équipements), des synergies (autour des déchets et de l’énergie) et des partenariats (offres touristiques mutualisées). Parce qu’en valorisant la richesse socio-économique et culturelle au niveau local, cette vision pousse naturellement à la diversification. Le territoire devient alors un levier de résilience face aux crises mais également un véritable outil de compétitivité pour les entreprises du tourisme, ce qui n’était pas forcément le cas avant. Et c’est plutôt réjouissant !
Propos recueillis par Elise Assibat