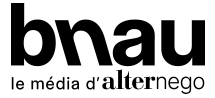La vie est complexe, et l’évolution de l’Homme n’encourage pas sa simplification. Il suffit d’observer les divers théâtres de rivalités de pouvoir qui existent aujourd’hui : alors qu’hier la guerre se limitait à l’espace physique (l’air, la terre et la mer), de nos jours les luttes d’influence se déroulent aussi sur l’espace hertzien, l’infosphère, le cyberespace, ou encore sur les réseaux sociaux. Ces nouveaux espaces autonomes tendent donc à reléguer le réel à la périphérie de l’action. Pour autant, nos cerveaux humains ne se réduisent pas à de froides exploitations de la « data », et le digital ne saurait se substituer à la réalité des liens sociaux.
Le digital vs. le réel = les plus jeunes vs. les plus âgés ?
Le développement des technologies de l’information et de la communication a conduit à des mutations temporelles et spatiales fondamentales, ouvrant la voie de notre actuelle révolution digitale. Peut-on attribuer au jeunes Y le monopole de cette compétence digitale au détriment des séniors ?
Oui, à en croire les représentations de l’imaginaire collectif : une étude sur les stéréotypes générationnels révèle que 55% des Y se perçoivent comme axés vers les nouvelles technologies, alors que les quadras n’évoquent ces compétences qu’à 11% pour leur génération et les séniors à 2% pour la leur.
Mais n’oublions pas que l’âge est une donnée biologique manipulée et manipulable, et que les divisions entre les âges sont arbitraires. Comme le souligne le sociologue Vincent Caradec, l’âge en tant que coordonnée sociale renvoie de fait à une double réalité :
- D’une part c’est être à un moment donné de son parcours de vie (avoir 25 ans et un statut de jeune salarié, ou en avoir 55 avec une longue expérience de vie derrière soi) ;
- D’autre part c’est inscrire sa naissance sur une temporalité particulière, et donc auprès d’une génération déterminée (ce qui amène certains à grandir avec la télévision, d’autres avec une tablette tactile).
Plus jeunes et plus âgés diffèrent donc doublement : par leur âge, c’est-à-dire leur place dans le parcours de vie, et par leur appartenance générationnelle[4]. Ainsi, l’arrogance n’est pas constitutive de la génération Y : si elle bouscule aujourd’hui les lignes par la force de ses questionnements, c’est à sa jeunesse qu’elle le doit. Une jeunesse dont Socrate faisait déjà la diatribe plusieurs centaines d’années avant l’émergence de la génération digitale : « les jeunes d’aujourd’hui aiment le luxe ; ils sont mal élevés, méprisent l’autorité, n’ont aucun respect pour leurs aînés, et bavardent au lieu de travailler ».
L’incompréhension générationnelle n’aide donc pas, et à l’exaspération des vieilles branches face à l’impétuosité des jeunes pousses, s’ajoute une nouvelle donne contextuelle : en matière digitale, le maître d’hier est souvent l’apprenti d’aujourd’hui. Les plus âgés ont donc à apprendre des plus jeunes, ce qui peut constituer une source de frustration pour les premiers, et un terreau propice à la suffisance des seconds. Néanmoins, les jeunes générations ne doivent pas négliger non seulement les savoirs et savoir-faire de leurs aînés mais aussi et surtout les savoir-être au cœur de la coopération et de la qualité de nos relations aux autres.
Un univers virtuel, une solitude réelle …
L’hyper-connectivité permet un niveau d’information et d’autonomie jamais atteint dans l’histoire de l’humanité. Le problème, Marguerite Duras l’avait prédit en 1985 : « Dans les années 2000, il n’y aura plus que des réponses. (…) Je crois que l’homme sera littéralement noyé dans l’information, dans une information constante ». L’infobésité serait le mal de notre 21e siècle, d’où cette « pathologie moderne de l’esprit », résultant de « l’hyper-simplification qui rend aveugle à la complexité du réel ». Trop d’informations tue l’information !
On commence à s’interroger sur l’objet même de ce nouveau monde numérique, qui ne se définit pas par son chiffre d’affaire, mais par sa capacité à établir des connections entre les utilisateurs (à l’instar de la course aux « j’aime »). Les réseaux sociaux impactent notre manière d’être en lien aux autres, et malgré la facilité qu’ils offrent pour communiquer, les Français n’ont jamais été aussi seuls. En effet, l’édition 2016 de l’étude de la Fondation de France sur les solitudes révèle que 5 millions de Français sont en situation objective d’isolement : c’est un million de plus qu’en 2010 !
Pléthore d’articles et d’études établissent une corrélation entre le temps passé sur les réseaux sociaux et le niveau de bonheur :
- En 2014, le Jour of Social and Clinical Psychology publiait un article avançant l’idée qu’à trop s’exposer au bonheur des autres (via le contenu mis en avant par ses « amis »), Facebook mettait en danger la santé mentale de ses utilisateurs, en augmentant sensiblement le risque de développer des symptômes dépressifs.
- En 2015, les chercheurs de l’Hapiness Research Institute ont mené une expérience auprès de 1095 Danois dont la moitié était privée de Facebook pendant une semaine. Les résultats sont sans appel : ceux qui s’étaient déconnectés toute la semaine se sentaient non seulement plus heureux (88% contre 81% pour ceux qui continuaient de consulter leur Facebook), mais aussi moins tristes (22% contre 34%) et moins seuls (16% contre 25%).
Sources de comparaison et de sollicitations permanentes, les réseaux sociaux mal utilisés peuvent générer de l’addiction, du mal être et paradoxalement de l’isolement. Nous sommes donc très loin du village global prophétisé par Marshall McLuhan en 1967, désignant un monde dans lequel les individus vivraient dans « un même temps, au même rythme et donc dans un même espace ». Le théoricien de la communication développait ainsi l’idée d’une société en temps réel, avec une interconnexion entre les individus devenue instantanée grâce à la technique. S’il est indéniable que les NBIC ont contribué à l’émergence d’une révolution économique, politique et sociétale, elles ne remplissent pas leur ambition quand elles se proclament également facilitantes du vivre ensemble.
Il paraît donc absolument nécessaire de faire dialoguer ce qu’il y a de plus moderne (le digital), et de plus archaïque (le don, à entendre dans son acception maussienne). Les usages les plus anciens ont non seulement jamais disparu, mais demeurent aussi au cœur des transformations organisationnelles et digitales que nous vivons. Pour autant, ce qui pouvait relever du bon sens autrefois, nécessite visiblement l’instauration de nouveaux rituels d’initiation.
Marcel Mauss a montré dans son Essai sur le don en 1925 que les rapports sociaux ne sont pas fondés sur le troc, le contrat ou encore le donnant-donnant, mais bien sur le don. Y circule des informations, des émotions, de l’entraide, des moments de convivialité, des compliments… autant d’éléments nécessaires pour pouvoir se fier aux uns et aux autres, pour constituer un collectif agile et innovant, et enfin pour briser les silos.
Il semblerait qu’à ce sujet les plus jeunes aient à apprendre de leurs aînés, puisque d’après les stéréotypes les plus courants : « ils ne communiquent pas, sont chacun avec leur portable et ont ce côté individuel dans l’entreprise ».
Les différences générationnelles : une opportunité essentielle
La vie est complexe, et pour résoudre cette complexité, il s’agit d’appréhender les dialectiques de l’existence en raisonnant avec le ET et non le OU, pour reprendre les écrits d’Edgar Morin : « c’est dans cette dialectique du complémentaire et de l’antagonisme que se trouve la complexité ».
L’explosion exponentielle des NBIC nous place à un tournant de l’humanité. Il ne s’agit pas d’être nostalgiques d’un paradis perdu, mais de saisir que pour parvenir à surmonter notre vulnérabilité dans cette grande transformation, Y, X et séniors ont à s’apporter mutuellement. Un fait économique irréversible (le digital) vient percuter un fait social immuable (le don), et chacun d’eux apporte une partie de la réponse du monde de demain. Se limiter au digital, c’est prendre le risque de s’isoler et de rater la mobilisation de ses partenaires. Se limiter au don, c’est prendre le risque de perdre en employabilité et en performance. D’où la nécessité de promouvoir l’inclusion et d’enrichir le travail par la complémentarité des différences en tirant un bénéfice mutuel de ces frictions intergénérationnelles.
Jean-Édouard Grésy et Valentine Poisson