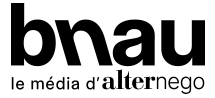C’est un fait social surprenant : alors que l’insécurité baisse tendanciellement dans nos sociétés, le sentiment d’insécurité demeure élevé, quand il n’est pas en augmentation.
On peut aussi s’interroger en observant qu’alors qu’il n’y a jamais eu autant de dispositifs de prévention des violences et incivilités au travail, le sentiment d’insécurité sur le lieu de travail touche aujourd’hui plus d’un salarié sur quatre.
Comment comprendre cet étonnant paradoxe ?
Un effet Baader-Meinhoff ?
Première hypothèse tentante pour expliquer la montée du sentiment d’insécurité à mesure que l’on renforce les systèmes de prévention : l’effet Baader-Meinhoff, aussi appelé illusion de fréquence. Ce biais d’attention s’exerce quand on entend tellement parler de quelque chose que l’on finit par voir cette chose partout.
Par exemple, constater qu’il y a de plus en plus de caméras de surveillance dans l’espace public peut artificiellement donner le sentiment qu’il y a de plus en plus de risques pour la sécurité des biens et personnes, comme le met en évidence Thomas Jousquiane dans son ouvrage Circulez ! La ville sous surveillance (Ed. Marchialy, 2024). Le sentiment d’insécurité nait parfois de l’omniprésence du thème de la sécurité.
Autre exemple : entendre de plus en plus souvent parler de harcèlement en entreprise peut rendre particulièrement réceptif aux signaux de la souffrance au travail. On serait tenté d’expliquer ainsi la spectaculaire inflation des signalements dans les entreprises dans la période post-MeToo. Depuis 2017, on n’a pas vu seulement une libération de la parole des femmes au sujet des agissements sexistes et sexuels, mais un déplacement global du curseur de tolérance de tous aux comportements inappropriés, aux relations dysfonctionnelles et au management dit toxique.
La vigilance, témoin du sentiment d’insécurité ou de sécurité ?
Les victimes et témoins qui se manifestent aujourd’hui sont-ils soumis à la seule illusion de fréquence qui leur ferait voir du harcèlement là où, du temps on n’en parlait pas, ils supportaient mieux les âpretés des relations de travail ? Nos observations et analyses révèlent plutôt une élévation du niveau de vigilance : chacun se montre plus attentif aux situations anormales, davantage en responsabilité d’agir pour faire cesser les comportements déviants… Et surtout de plus en plus autorisé à (se) signaler (Donzel & Ringrave, Harcèlements, au-delà des clichés, Mardaga, 2023)
Aussi, il est permis d’affirmer que la vigilance peut être le signe d’une hausse du sentiment de sécurité : je prends la parole parce que je me sens légitimité à le faire et que j’ai une certaine confiance dans la capacité de l’organisation à m’écouter et à prendre en considération ce que j’adresse.
Peut-on se sentir en insécurité quand on est en sécurité ?
A ce stade, il est donc impossible de dire si les mesures de prévention ont sur le sentiment de sécurité un effet réducteur (comme dans le cas des caméras de surveillance) ou un effet amplificateur (comme dans le cas des dispositifs de prévention des harcèlements en entreprise).
Peut-être parce que le sentiment de sécurité n’est en fait que peu corrélé aux conditions réelles de sécurité. Pour s’en convaincre, il suffit de constater que plus de 25% des voyageurs ont peur en avion (5% sont littéralement phobiques) alors même qu’il s’agit objectivement du moyen de transport le plus sûr au monde. On peut aussi citer en exemple le fait qu’une femme sur cinq ressente souvent de la peur en circulant de nuit dans l’espace public alors qu’il est documenté qu’elle court moins de risques que les hommes dans la rue mais sera en revanche surexposée au danger d’agression (par un proche) dans l’espace privé.
Ainsi, je peux me sentir en insécurité alors même que je suis statistiquement en sécurité (dans l’avion, dans la rue). Et en sécurité alors que je suis statistiquement exposé·e à plus de risques (chez moi davantage que dans l’espace public).
Sentiment d’insécurité et impuissance acquise
On comprend donc que l’on ne répond pas au sentiment d’insécurité seulement par des mesures de sécurité.
Pour faire reculer le sentiment d’insécurité, il faut s’en prendre à ce qui le cause. Au croisement de la littérature disponible en sciences politiques (par exemple les travaux de Sebastian Roché ou d’Hugues Lagrange à la suite de ceux de Franck Furstenberg) et en psychosociologie, une ligne de fuite se dessine : le sentiment d’insécurité est étroitement lié à l’absence ou à la perte de maîtrise.
Ainsi, les populations les plus exposées à l’impuissance acquise sont celles chez qui le sentiment d’insécurité est le plus résistant. Pour Seligman, à l’origine du concept d’impuissance acquise, cette impression de ne rien (ou quasiment rien) pouvoir faire pour se protéger et se défendre est le résultat d’expériences négatives qui minent l’estime de soi et la confiance en soi.
La sociologie, et plus particulièrement les études de genre, étendent les facteurs de l’impuissance acquise à l’ensemble des conditions de socialisation qui inscrivent les personnes dans la soumission, l’exclusion, la dévalorisation. Aussi, en contexte patriarcal, les femmes sont-elles plus sujettes au sentiment d’impuissance et donc d’insécurité. En environnement jeuniste, ce sont les plus âgés. En contexte validiste, les personnes en situation de handicap, etc.
Augmenter l’agentivité, facteur de sentiment de sécurité
Si l’on veut renforcer le sentiment de sécurité, il va donc falloir rendre la conscience de leur pouvoir d’agir à celles et ceux qui ont en quelque sorte été “convaincus” de leur impuissance.
La philosophe Judith Butler plaide pour des politiques de l’agentivité. L’agentivité, agency en langue originale, c’est le fait de « ne pas être agi » mais de « pouvoir agir ».
Autrement dit, nous sommes « agis » dans les situations où la norme (les stéréotypes, les codes, l’ordre social, les règles du jeu et même, dans l’absolu le dispositif de sécurité) nous impose une position, nous oblige à des postures, nous poste à des fonctions en nous laissant peu de liberté de mouvement (physique et symbolique).
A l’inverse, nous sommes « agentifs » quand nous pouvons agir sur le système, non seulement pour nous protéger et nous défendre en son sein, mais aussi et surtout pour œuvrer à le rendre plus sûr pour nous. Cela implique notamment le fait de pouvoir en faire évoluer les normes, les ordres symboliques, les règles d’organisation et tout ce qui dans le cadre contribue à changer les postures et pratiques des uns et des autres.
Il est donc possible d’augmenter le sentiment de sécurité, y compris des plus vulnérables, en leur restituant de la latitude décisionnelle pour eux-mêmes et du pouvoir d’agir sur leur environnement.
Marie Donzel