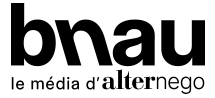En 2024, le Président de la République française promettait de réformer le congé parental dans le sens du raccourcissement de sa durée et de l’augmentation de son indemnisation. Il s’agissait de faire des économies certes, mais aussi de réduire les impacts de l’éloignement du travail sur la carrière des femmes et d’encourager davantage d’hommes à partager les responsabilités domestiques et parentales dans cette période charnière pour l’égalité au sein des couples qu’est l’arrivée d’un enfant. Ce projet de réforme est ajourné. Cela nous laisse le temps de regarder ce qui se fait ailleurs…
La Suède, particulièrement « généreuse » en matière de congé parental
Est-ce qu’il faut que le congé soit plus bref que les pères le prennent ? Pas si sûr ! La Suède est le pays qui offre le congé parental le plus long au monde (240 jours par parent) et c’est aussi celui où les hommes sont les plus nombreux à le demander (près de 90% des pères y ont recours).
Est-ce que les pères suédois sont motivés aussi par le niveau de rémunération de ce congé ? Ce qui est sûr, c’est que le pays scandinave est le plus généreux du monde en la matière, avec une indemnité correspondant à 80% du salaire sur 80% de la durée maximale du congé.
Avec cela, la Suède a choisi en 2024 de permettre le transfert de 90 jours de congé parental à une personne qui n’est pas le tuteur légal de l’enfant (par exemple, un grand-parent, un oncle ou une tante), toujours en bénéficiant d’une indemnisation à hauteur de 80% de leur rémunération ou pension.
Un historique de politiques socio-démographiques progressistes
Mais qu’est-ce qui pousse les Suédois à tant de largesses ? Pour répondre à cette question, il faut remonter aux origines des politiques d’égalité femmes/hommes dans la région scandinave. Celles-ci sont d’abord mues par un enjeu démographique.
Il n’y a pas suffisamment de monde en Suède, en Norvège ou en Finlande pour se permettre de n’avoir que la moitié de la population au boulot. Voilà donc plus d’un siècle que ces pays ont conscience que le travail des femmes, c’est vital pour leur économie.
Mais comme la démographie est en tension, il ne faudrait pas que l’activité professionnelle des femmes ait des effets dépresseurs sur la natalité. Alors, dès les années 1950, la Suède d’abord et à sa suite les autres pays du Nord mettent en place des politiques familiales particulièrement ambitieuses sur le terrain de la conciliation des temps de vie et du partage des responsabilités familiales.
Quand parentalité rime avec productivité
Des politiques coûteuses ? Non, des politiques qui rapportent ! La Norvège est le pays qui affiche le meilleur taux de productivité du travail à l’échelle mondiale. Sur ce même indicateur, la Suède et la Finlande se classent au-dessus du Canada, de la France, du Royaume-Uni et du Japon, entre autres.
Rien d’étonnant à cela si l’on se réfère aux travaux des épidémiologistes Pickett & Wilkinson qui ont mis en évidence dans leur ouvrage Pour vivre heureux vivons égaux, le rôle majeur des politiques sociales matures sur toute une série de marqueurs de réduction des coûts et de développement économique. On tombe moins malade, on vit plus longtemps en bonne santé et on a moins d’accident là où les entreprises affichent les meilleurs niveaux de parité, là où le partage des responsabilités professionnelles et des responsabilités familiales est le plus équilibré, là où les parents ont vraiment du temps et de la disponibilité pour s’occuper des enfants…
Les conditions de l’impact
Le plus intéressant, c’est qu’il n’y a pas si longtemps à attendre pour qu’une société et son économie bénéficient des avantages induits par ses investissements dans une politique de parentalité progressiste. On peut observer des impacts sensibles sur la natalité, sur la productivité au travail, sur la réduction du turn-over et sur l’apaisement des relations sociales en moins d’une décennie.
À une condition toutefois : l’ambition. Selon l’économiste Hélène Périvier, spécialiste des politiques publiques d’égalité femmes/hommes, les réformes à la marge et les mesures de faible envergure en matière de parentalité ne produisent aucun effet structurant sur l’évolution des pratiques et des mentalités. Ainsi peuvent s’expliquer les résultats décevants des dernières réformes du congé parental sur le plan de la lutte contre le plafond de verre, celui des gains pour les familles comme celui de la productivité. Les ménages et en leur sein les pères n’ont pas vu suffisamment leur intérêt à transformer leurs habitudes de partage des responsabilités familiales et plus largement leur rapport au travail pour s’emparer pleinement de ces dispositifs. Alors oui, dans ces circonstances, on peut considérer que c’est un coût pour les finances publiques plus qu’un investissement pour l’efficacité
Ce qui « coûte un pognon de dingue », c’est de ne pas investir suffisamment. On le sait tous, intuitivement : on gagne petit (voire on mise à fonds perdus) quand on joue petit. En matière de politiques d’accompagnement à la parentalité, voir grand n’est pas une option. D’ailleurs, dans son dernier rapport sur la politique d’accueil du jeune enfant rendu public en décembre 2024, la Cour des Comptes ne s’y trompe pas qui préconise l’allongement des congés de maternité et paternité ainsi que l’augmentation de l’indemnisation du congé parental. Parce qu’elle est dans son rôle, la Cour argumente sur les effets en matière d’allègement de la pression sur le financement des modes de garde. Mais si on prolonge le raisonnement au-delà de la seule réduction des coûts (des dispositifs publics et des aides au financement pour la garde d’enfant) pour envisager des gisements de valeur économique et sociale, il se pourrait bien qu’il y ait tout à gagner à la jouer comme la Suède.