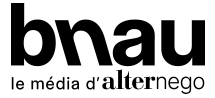Vendredi 31 mars dernier signe une journée historique dans l’histoire des syndicats : Sophie Binet est élue à la tête de la CGT. Elle devient ainsi la première femme à occuper la fonction de secrétaire générale depuis la création de l’organisation syndicale en 1895.
Si l’événement marque un tournant en faveur des femmes engagées, la victoire de Sophie Binet donne aussi l’occasion de revenir sur la complexité des enjeux de mixité au sein des organisations syndicales. Une réalité qui pose question, notamment quand on sait que : « les difficultés à être une femme à la CGT, à y prendre toute sa place, et notamment des responsabilités, sans sexisme ni violence, persistent à un niveau élevé et préoccupant, et l’écart entre les valeurs affichées et les actes est dénoncé » selon un rapport commandé par la confédération en 2019. Alors comment expliquer ces inégalités entre les hommes et les femmes qui persistent au sein des organisations syndicales ? Décryptage par Clémentine Buisson, experte Alternego en diversité et inclusion.
Une légitimité niée par les syndicats du siècle dernier
Historiquement, le syndicat est un outil permettant de défendre les intérêts des ouvriers face au patronat dès 1885 avec la création de la CGT (Confédération Générale du Travail, NDLR). La lutte syndicale s’inscrit alors dans le même ordre de priorité que les luttes communistes et socialistes. La lutte des classes doit primer et toutes les autres formes d’oppression sont plus ou moins mises de côté. Les syndicats les plus importants étaient et restent ceux des ouvriers qualifiés. La forte stratification genrée du marché du travail a donc retardé l’entrée des femmes dans les syndicats, les secteurs majoritairement féminisés étant peu représentés.
Selon les sociologues du travail Cécile Guillaume et Sophie Pochic dans « Syndicalisme et représentation des femmes au travail », on peut également parler d’une certaine méfiance vis à vis de l’emploi des femmes. On apprend alors dans leurs travaux que ces dernières étaient considérées comme “l’armée de réserve” du patronat, notamment à cause de leur bas-salaires. Dans certains secteurs comme celui de l’imprimerie, elles étaient d’ailleurs souvent souvent choisies pour remplacer des ouvriers. Avant 1914, ces débats houleux opposent même directement les syndicats aux mouvements féministes alors considérés comme bourgeois. Mais les processus d’exclusion délibérée des femmes concernent surtout les milieux fortement masculins où se jouait une plus forte relation de pouvoir et de concurrence. Dans les domaines traditionnellement féminins, les femmes étaient tolérées par les syndicats. Ailleurs, le mythe de l’ouvrier assurant la pérennité de son foyer prévalait et cela était constitutif de l’identité ouvrière masculine. Laisser la place aux femmes dans les organisations syndicales revenait donc à remettre en cause ce modèle culturel.
Un tournant historique : les grèves de 1917-1918
L’importance des grèves de femmes de 1917-1918 et l’implication croissante des femmes dans le mouvement ouvrier donnent lieu à des pratiques d’inclusion des femmes dans les années suivantes. La CGT est précurseur en la matière puisqu’elle publie à partir de 1955 la revue Antoinette (un mensuel dédiée à un lectorat de femmes, NDLR) sur les questions de syndicalisme et de féminisme. De plus, la CGT propose des formations spécialement pour les femmes, et permet la création de commission de femmes. Pour Cécile Guillaume dans « Syndiquées », ces structures avaient alors pour but “d’apprivoiser les femmes” dans les années 1920, puis dans les années 1960 “d’aider les femmes à trouver leur place dans le syndicat”.
Pour autant, ces avancées se sont faites avec en toile de fond l’idéal “égalitariste-conservateur”. La lutte des classes reste la priorité, ce qui se traduit également par une “mise sous tutelle paternaliste des collectifs féminins au niveau local”, toujours selon la sociologue. Finalement, les seules expériences non-mixtes réellement autonomes sont celles des syndicats chrétiens exclusivement féminins, qui se sont créés dès 1906 et, par la suite, affiliés à la CFTC. La CFTC comporte alors près de 37% d’adhérentes au moment de sa création et a pour but, selon Cécile Guillaume et Sophie Pochic, de “défendre les intérêts féminins par d’autres moyens que la grève et offrent un espace de sociabilités féminines”.
La désyndicalisation des années 70 pousse les syndicats à se tourner vers les femmes
Ces expériences sont néanmoins minoritaires et plusieurs forces vont au contraire pousser les syndicats à promouvoir plus de mixité notamment à partir des années 1970. Les mouvements féministes des années 1970 peuvent expliquer cette décision d’une part. Mais également “l’instabilité des structures hiérarchiques du fait de la désyndicalisation et de fusion de syndicats” pour Cécile Guillaume. En effet, le taux de syndicalisation des ouvriers passe de 54% en 1979 à 29% en 2005, alors même que le taux d’emploi des femmes est en croissance, passant de 45% en 1979 à 73% en 2005. Les syndicats sont alors également poussés par une perspective utilitariste, et cherchent donc à trouver de nouvelles cibles pour obtenir de nouveaux adhérents.
Les politiques de mixité chez les syndicats : une volonté de compenser le déficit démocratique
Les organisations syndicales qui se sont attelées à la tâche sont majoritairement passées par des politiques volontaristes de mise en place de quotas. C’est le cas par exemple de la CFDT qui dès 1982 met en place des quotas pour ses instances exécutives. L’objectif ? Obtenir une mixité proportionnelle à la part des adhérentes dans l’ensemble des syndiqués. Néanmoins, les femmes constituent aujourd’hui environ un tiers des instances nationales de la CFDT pour 47% d’adhérentes.
La CGT a suivi cette tendance avec l’instauration de la parité dans ses plus hautes instances en 1999, alors même qu’elle ne comporte que 37% d’adhérentes. En 2007, la CGT adopte une charte de l’égalité, qui a pour objectif principal le “gender mainstreaming”. C’est-à -dire le fait de tout considérer au prisme du genre, dans toutes les instances et tous les domaines, rappelle Cécile Guillaume. Mais le niveau de transformation entre les différentes organisations est inégal. Seules la CFDT et la CGT ont effectué des recensements officiels pour déterminer le nombre de femmes. Le syndicat FO lui, a par exemple seulement procédé à des estimations.
Les limites des politiques de mixité
Des politiques de mixité comportent des limites puisque les inégalités femmes-hommes dans les syndicats persistent. La première limite, est que les quotas ne produisent pas nécessairement d’effet de ruissellement. Et donc, là où il n’y a pas de quotas, il y a peu de femmes. Dans le cas de la CFDT par exemple, si la commission exécutive est paritaire, il y seulement 28% de femmes secrétaires générales d’union départementale en 2016, poursuit Cécile Guillaume dans « Syndiquées ». De plus, le fait qu’il y ait plus de femmes dans les instances exécutives ne veut pas dire non plus que les intérêts des femmes sont mieux portés.
En effet, bien que tous les syndicats déplorent la situation des femmes sur le marché du travail et plaident pour plus d’égalité, la réalité démocratique de ces mêmes organisations ne correspond pas toujours à cet affichage politique. Sur le site internet de Force Ouvrière, on peut ainsi trouver un dossier “égalité professionnelle” sans pour autant que ce syndicat ne remette en cause ses pratiques démocratiques. Les barrières structurelles à l’entrée des femmes dans les syndicats sont donc encore nombreuses.
Des barrières structurelles pour les femmes…
La stratification du marché du travail pourrait alors expliquer la persistance de ces inégalités. Les femmes sont plus concernées par le temps partiel et les emplois plus précaires. Aussi, cela les empêche parfois d’acquérir la légitimité nécessaire auprès de leurs collègues pour devenir représentante syndicale et ensuite gagner en responsabilité. D’autres part les structures de ces emplois (changements fréquents d’emplois, changements d’horaires, pas de lieux fixes de travail dans le cas du personnel d’entretien par exemple…) permettent peu la concrétisation d’un engagement syndical. Cependant, même dans le secteur public, pourtant moins précaire et mieux surreprésenté, s’observe un phénomène de plafond de verre qui continue de persister.
Mais aussi culturelles
Au-delà de ces barrières structurelles, on peut donc interroger les réticences culturelles, encore bien ancrées. Il existe en effet beaucoup de règles informelles basées sur des savoirs êtres qui correspondent à la masculinité hégémonique et qui constituent dans une certaine mesure une forme de culture syndicale viriliste. Aux yeux d’Isabelle, militante rapidement sollicitée par la CFDT pour devenir syndicaliste, son adhésion s’explique notamment par son caractère. “Déjà à l’époque je l’ouvrais quoi, j’avais déjà du caractère, j’avais déjà du tempérament, je défendais mes collègues sans être syndicaliste”, cite Cécile Guillaume dans « Syndiquées ». Une impression qui n’a rien d’anormale quand on sait que ces traits relèvent, dans l’imaginaire social et culturel, d’un comportement typiquement masculin. En opposition aux femmes donc, qui n’auraient ni la voix ni la confiance nécessaire pour s’affirmer dans un poste réputé pour devoir “l’ouvrir”.
En outre, la culture organisationnelle des syndicats pèse très fortement sur la difficulté des femmes à évoluer dans leur syndicat. Sans compter le système de cumul des mandats représentatifs, également défavorable aux femmes, dans la mesure où les hommes en cumulent historiquement davantage, ajoute la sociologue. Ces derniers gagnent alors en légitimité et sont donc plus facilement cooptés par leurs pairs. Mais ce n’est pas tout. Une fois que ces dernières peuvent enfin commencer à s’engager, elles sont confrontées à de nouvelles difficultés : articuler leur vie familiale, professionnelle, et syndicale.
Il est alors intéressant de se demander comment cette volonté de palier un déficit démocratique interne aux syndicats peut aujourd’hui infuser dans les propositions et contributions portées par ces derniers. Finalement, l’enjeu n’est donc pas seulement de devenir des organisations plus démocratiques… Mais également de représenter au mieux les travailleurs et travailleuses pour prendre en compte l’ensemble des enjeux liés à l’emploi.
Clémentine Buisson, avec la précieuse relecture d’Elise Assibat