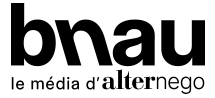Face à la crise écologique que nous traversons, plus aucun doute ne persiste quant à notre responsabilité d’enclencher des changements concrets. Pourtant, force est de constater que l’action n’est pas à la hauteur, tant s’en faut.
Après une COP 28 à l’issue mitigée, la question mérite d’être à nouveau posée : comment expliquer un tel paradoxe ? Et comment s’y confronter ? Décryptage philosophique avec Sophie Berlioz, manager senior.
D’où vient l’inaction face au désastre écologique ?
Sophie Berlioz : Les difficultés pour impulser des actions en faveur de l’écologie renvoient à leur lien étroit à nos modes de vie, de consommation et plus globalement au système de l’économie de marché globalisée. Nous savons aujourd’hui qu’à côté des promesses de progrès de la modernité se nichent toutes sortes de maux : pollution, creusement des inégalités, catastrophes industrielles ou nucléaires, menaces sur l’environnement…. Ces dommages collatéraux ont pu générer une forme de désenchantement, qu’Ulrich Beck qualifie dans la Société du risque de « rupture à l’intérieur de la modernité ».
Comment cette rupture se traduit-elle concrètement ?
S. B : Elle passe avant tout par une perte de confiance d’une partie de la population envers la rationalité scientifique et technique. Aujourd’hui, les dimensions de progrès, de techniques et de science ne font plus pleinement consensus. Et c’est cette défiance même qui explique en partie les raisons pour lesquelles la perception sociale du risque écologique diffère de sa définition rationnelle. Le phénomène est perçu intellectuellement, mais il n’est pas reconnu ni vécu dans sa dimension émotionnelle. Dénié ou pour le moins relativisé, sans doute du fait de son caractère lointain face à l’imminence d’autres risques liés aux conditions de travail, aux inégalités, au sous-développement d’une grande partie du monde… Le court-terme offre suffisamment de raisons pour empêcher la projection.
Alors comment faire le lien entre les deux systèmes économiques et écologiques ?
S. B : En épousant très certainement la culture de la synthèse et du dépassement soufflée parla dialectique d’Hegel. C’est-à-dire en considérant que l’un et l’autre ne s’opposent pas mais sont indissociables. Pour les entreprises, la culture du dépassement prendrait la forme d’un devoir de vigilance vis-à-vis de leurs parties prenantes (salariés, consommateurs, environnement). Autrement dit, cette réconciliation, qui commence à être impulsée par les pouvoirs publics (mais dont les marges de manoeuvre sont modérées) passe par la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Ce que Hans Jonas définit dans son éthique de responsabilité par un impératif catégorique : « Agis de telle sorte que ton action soit compatible avec la permanence d’une vie authentiquement humaine ». Le chemin vers l’application de cet impératif passe donc par nécessairement par l’action des entreprises et par une réflexion profonde sur leurs impacts sur leurs environnements. À la fois écologiques et sociaux.