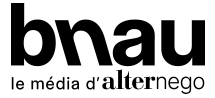Depuis plusieurs semaines, le coronavirus expose l’Europe et la France à des impasses. Ces impasses se traduisent notamment par des dilemmes décisionnels posés aux personnels hospitaliers. Qui choisir en situation de saturation des urgences ? Comment décider et sur quels critères ? Quels critères permettent-ils d’évaluer le sacrifice d’une vie pour en sauver une autre ? L’âge ? La norme implicite du « premier arrivé, premier soigné » ?
Dans une intensité moindre, ces dilemmes se posent également aux Directions d’entreprise dans le cadre de la perturbation de leurs activités et de l’instabilité économique. Est-il préférable d’opter pour le chômage partiel collectif ou de procéder au licenciement au cas par cas ? Quoi privilégier, la compétence à la performance collective ou l’ancienneté ? À compétence égale, la situation familiale et personnelle doivent-elles être prise en compte ?
Chaque situation de dilemme implique des choix moraux qui reposent sur les valeurs d’un individu, d’un collectif ou d’une société. Par exemple, lorsqu’ils manquent de moyens d’accueil et de soin, certains hôpitaux italiens ont privilégié les critères de l’âge et de la bonne santé dans le choix des vies à sauver. Cela fait froid dans le dos. C’est pourtant bien réel.
Ces situations de dilemmes décisionnels continueront de se poser, voire augmenteront, tant que les situations de déni ou de dénégation psychologiques des personnes persisteront. En effet, plus le déni est à l’œuvre, moins les règles sont observées, et plus la contagion sera d’ampleur et le temps de confinement long. Et plus les dilemmes moraux risqueront de se poser.
Pour parler du déni, Albert Camus écrivait ceci dans La Peste : « Beaucoup cependant espéraient toujours que l’épidémie allait s’arrêter et qu’ils seraient épargnés avec leur famille. En conséquence, ils ne se sentaient encore obligés à rien ». Comment alors identifier et résoudre le déni ? Comment prévenir à la racine les situations de dilemmes ?
Sortir du déni pour nous protéger collectivement
« Sauvez des vies. Restez chez vous ! » Voilà depuis le 18 mars 2020, le nouveau mot d’ordre en France, emboîtant le pas à l’Italie confinée depuis plusieurs semaines déjà, et devançant d’autres pays occidentaux. Tenter vaille que vaille d’aplanir la courbe des contaminations, d’endiguer la pandémie du COVID-19 qui se propage dans le monde à la vitesse d’une respiration. Nous en sommes là.
Le confinement s’est ainsi imposé, notamment parce que les Français ne respectaient pas assez les consignes de sécurité sanitaire. C’est qu’il faisait beau le week-end du 15 mars 2020. C’était le printemps, le temps idéal pour sortir dans les parcs, aller sur les plages, acheter des fleurs, pour voter aussi. C’était le premier tour des élections municipales…
Aurions-nous été sous les effets d’un déni collectif du danger réel de la crise sanitaire qui s’annonçait ? Un déni dont l’impact, inéluctablement, aurait été une augmentation des contaminations et le dépassement des capacités de notre système hospitalier déjà au bord de saturation ?
Tout était pourtant devant nous. On savait pour la Chine, les images de Wuhan, les cadavres dont on nous disait qu’on ne savait plus où les mettre. C’était en Une du Monde. Il y avait eu Mulhouse aussi, où la contamination s’était propagée à l’occasion d’une messe. Creil, à la porte de Paris, les Contamines, station de ski alpine proche de l’Italie. On savait, mais on ne croyait pas. Collectivement, on ne croyait pas. La croyance écrasait la connaissance.
Que s’est-il passé ? Quelles leçons en tirer pour l’avenir ?
Le déni, cette fonction vitale qui nous protège d’une angoisse
Le déni, en psychologie, est un mécanisme de défense de la psyché pour la protéger d’une angoisse profonde, d’un effondrement potentiel. Il remplit ainsi une fonction vitale. Il désigne le fait de ne pas percevoir quelque chose qui est, de ne pas la connaître. Dans notre actualité, cela équivaut, par exemple, à ne pas ne pas entendre, ni intégrer les informations sur le COVID-19. Les informations ne percent pas la surface de l’inconscient pour devenir pensables, tant les conséquences sont menaçantes pour la psyché. Par protection, le voile est préférable. Le voile d’ignorance. J’ignore.
Le déni est à distinguer d’un autre mécanisme de défense tout aussi involontaire, la dénégation qui, elle, signifie le fait de connaître quelque chose qui est, existe mais de ne pas la reconnaître. Le phénomène est alors perçu intellectuellement, mais il n’est pas reconnu ni vécu dans sa dimension émotionnelle.
C’est sans doute de dénégation dont il s’est agit à la mi-mars. L’observation de comportements collectifs d’insouciance en complet décalage avec le caractère menaçant de la réalité de l’épidémie. Certes, la dangerosité de la situation était connue, difficile de lui échapper à l’heure de l’information continue, mais elle n’était pas nécessairement ramenée à une expérience émotionnelle pour soi : « Certes, il y a des morts, mais ça ne risque pas de m’arriver à moi. Je ne cèderai pas à la psychose. Je suis plus fort que ça alors autant profiter du beau temps ».
Éviter de nous nuire pour ne pas nous tuer
Mais la dénégation ne serait rien si elle n’avait pas été couplée à un danger réel. Car évidemment ces mesures visaient bien à nous protéger et à nous empêcher de nous nuire pour ne pas nous tuer. A nous empêcher de nuire aux plus vulnérables, à commencer par nous-mêmes, vulnérables que nous sommes, à réduire autant que possible le nombre de patients à traiter dans des hôpitaux saturés et en manque de moyens, à éviter aussi par-dessus tout de devoir choisir entre les patients à traiter.
Car chez nos voisins d’Italie, les événements liés au coronavirus ont pris un tour cornélien. On l’a vu dans des hôpitaux comme ceux de Bergame où faute de place et de moyens, certains patients âgés ou à la santé affaiblie ont été sacrifiés pour sauver d’autres vies. Ces situations de dilemmes décisionnels que la littérature philosophique traite d’ordinaire comme des expériences de pensées pour évaluer nos intuitions morales sont devenus réelles. Cette épidémie fait surgir des dilemmes. Est-il admis de sacrifier une vie humaine si elle me permet d’en sauver plusieurs ? Dois-je privilégier la femme enceinte ou le vieil homme ? Les enfants ou les adultes ?
La liste des cas pourrait être longue, et dans ces situations extrêmes, il n’y a pas une bonne manière d’agir. Je peux accepter le sacrifice d’une personne pour sauver un maximum de vies, c’est l’approche conséquentialiste. Mais je peux aussi refuser le sacrifice d’un être humain car je ne puis traiter autrui comme un moyen, toujours comme une fin. C’est l’approche déontologiste.
Ces dilemmes sont insolubles. Ils ne sont ni tranchés par le droit, ni par l’État, ni par le Comité d’éthique. Ils sont traités au cas par cas, en situation. Mais force est de constater que c’est l’option conséquentialiste qui tend à prévaloir dans nos sociétés. Le sacrifice donc pour maximiser le nombre de vies. Ces dilemmes trouvent aujourd’hui une dimension glaçante dans les décisions qui se posent aux personnels hospitaliers en situation de saturation. En Italie, bientôt en France ? Permettons-nous cependant d’espérer le contraire.
Analysables d’un point de vue rationnel, ces dilemmes de décisions n’en restent pas moins extrêmement difficiles à résoudre d’un point de vue psychologique. Il s’agit de décisions lourdes et pesantes. S’il semble aujourd’hui difficile de les éviter, il est encore possible de les limiter. Comment ?
Pour limiter les dilemmes, accepter notre vulnérabilité
L’approche peut être multiple et dépend à la fois de chacun, individuellement, et de la société, collectivement. La dénégation est un défaut de reconnaissance du réel, de ce qui est objectivement, au profit d’une réalité construite par soi et pour soi, un produit issu de notre perception et de notre vécu du réel. La solution pour prévenir ce biais subjectif ?
Individuellement, nous astreindre à reconnaître les faits, à ce que nous pouvons savoir objectivement. Privilégier la connaissance sur la croyance : l’évolution de l’épidémie, sa trajectoire, ses épicentres, la capacité d’accueil et de soin des malades, la non-existence d’un vaccin, la létalité, les mesures de protection efficaces. Et collectivement, diffuser une information transparente et adéquate. Les pouvoirs publics et les médias en ont la responsabilité, ils doivent en être les garants.
Mais la dénégation est également une stratégie d’évitement inconsciente de la peur. Cette émotion dont on ne cesse de nous rappeler dans nos carrières professionnelles qu’elle est celles des plus faibles. Intéressant de constater que dans ces circonstances, elle s’avère raisonnable et même rationnelle. La peur motrice, dont on nous dit d’ailleurs qu’elle est celle qui a garanti la survie de notre espèce. La peur serait-elle bonne conseillère ? Comme le doute ? Alors pourquoi ne pas se le dire enfin. L’accueillir, simplement. Elle est légitime, la peur. La peur de la mort, pour nous-mêmes comme pour nos proches, la perte de l’ordre du monde tel que nous le connaissions, l’insécurité économique et politique, etc.
Enfin, sur quoi s’appuyer pour faire face à cette situation d’instabilité ?
Le soutien et le réconfort que l’on peut trouver dans les relations avec ses proches, et éventuellement un accompagnement psychothérapeutique. La reconnaissance de ses qualités propres, celles qui ont permis de traverser d’autres crises par le passé. Des qualités comme l’intelligence, le courage, la créativité, la ténacité, l’humilité, etc.; mais aussi ses croyances, ses valeurs et ses convictions, en guise de leitmotiv, de phare dans la tempête. Et si cette crise était aussi l’occasion d’apprendre à mieux se connaître, dans sa vulnérabilité et dans sa force ?
Sophie Berlioz & Stefanie Reetz