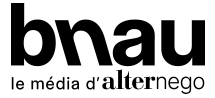Depuis sa création, le cinéma a toujours été un miroir du monde et de ses transformations. En tant que tel, il ne peut rester imperméable aux enjeux de notre époque. Critiquée sur bien des aspects, la filière réinvente aujourd’hui ses pratiques : réduire l’empreinte écologique des tournages, garantir la sécurité de toutes et tous sur les plateaux, faire évoluer les récits à l’écran… Un nouvel âge du cinéma, qui pense autrement la création, semble émerger. Et si cette transformation pouvait inspirer d’autres secteurs à travailler autrement ?
Réduire l’empreinte environnementale : l’obligation comme levier d’innovation
Derrière les fictions projetées sur grand écran, le cinéma, comme tous les secteurs, n’échappe pas à la réalité de son empreinte écologique. Selon une étude de 2021 menée par le Shift Project, le cinéma français génère 1,7 million de tonnes de CO₂ par an, une empreinte comparable à celle d’une ville comme Reims. Un tournage de long-métrage émet en moyenne 1 000 tonnes de CO₂, soit l’équivalent de 500 allers-retours Paris-New York. Sans compter les nombreux déplacements des équipes, la construction éphémère de décors, la consommation énergétique du matériel ou la fabrication de costumes et accessoires sont autant de postes à fort impact.
Au-delà de la production, l’exploitation pèse également lourd. L’impact des salles de cinéma (chauffage, climatisation) et surtout le visionnage en streaming à la maison (près de 5,6 MtCO2 en France en 2022) constituent un défi majeur.
De la prise de conscience à l’action
Face à ces constats, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a lancé le “Plan Action !” en 2021, marquant un changement d’optique. Via une conditionnalité des aides, les productions doivent présenter un double bilan carbone, provisoire et définitif, à l’aide d’outils homologués, comme le calculateur de l’association Ecoprod. Si ce plan se limite, pour l’instant, à un simple aspect déclaratif, il a permis de lancer une dynamique de changement concret des usages. L’association La Ressourcerie du Cinéma se consacre par exemple à donner une seconde vie aux décors, costumes et accessoires, limitant le gaspillage de matériaux une fois la production d’un film terminée.
Un nouveau métier a également émergé sur les tournages : le coordinateur d’éco-production, sorte de référent environnement du plateau, en lien avec chaque département. Parmi ses démarches : limiter les consommations d’énergie, privilégier la location, faire appel à des acteurs locaux, instaurer des repas végétariens, organiser le covoiturage… Le tout en étant le plus pédagogue possible, pour normaliser ces pratiques. Son rôle permet d’ailleurs de jouer sur un élément insoupçonné : le temps. En ralentissant les calendriers de production, il crée les conditions pour mieux anticiper les solutions circulaires.
Transformer les imaginaires
Au-delà des usages, c’est aussi l’imaginaire du cinéma qui doit évoluer. Le Collectif Les Toiles Vertes a ainsi lancé cette année le “Planet&People Test”, pour analyser les représentations environnementales et sociétales des films nommés aux César 2025. Les données recueillies, qui quantifient le ressenti des spectateurs, ont été croisées avec les analyses quantitatives de l’Observatoire des Imaginaires pour comprendre comment les représentations des enjeux écologiques et sociétaux influencent la perception qu’en a le public. Les résultats ont montré que les spectateurs “repèrent volontiers comme positifs les représentations des mobilités douces”, alors même que sur les 16 films nommés, le vélo n’apparaît que dans l’un d’entre eux… Le cinéma doit non seulement changer ses méthodes, mais aussi ses récits.
La longue route de la parité dans le 7e art
Après l’écologie, les transformations touchent aussi la culture de travail. Et en matière de parité, le cinéma reste marqué par de fortes inégalités. Selon une étude de l’Observatoire de l’égalité femmes-hommes du CNC, 25 % des films d’initiative française agréés ont été strictement réalisés par des femmes en 2023. Les budgets alloués aux films réalisés par des femmes sont en moyenne 25 % inférieurs à ceux réalisés par des hommes. Toujours largement présentes aux postes maquillage, costumes et coiffures, les femmes restent rares aux postes techniques comme le mixage (9,3 %) et parmi les machinistes prises de vues (9,2 %). À noter enfin que les inégalités salariales ont tendance à se creuser…
Sécuriser les plateaux et les relations
Mais le milieu ne reste cependant pas les bras croisés. Le Collectif 50/50 propose par exemple des annuaires pour constituer les équipes, des programmes de mentorat pour accompagner les jeunes talents ou des chartes d’engagement. Créé en 2018 suite à l’affaire Weinstein, le collectif lutte également contre les violences faites aux femmes sur les plateaux de tournage. Et dans le domaine, la formation obligatoire à la prévention et la lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels (VHSS) est une avancée majeure. Depuis 2021, tous les producteurs souhaitant bénéficier des aides du CNC doivent y assister. Toutes les équipes de tournage sont concernées depuis le 1er janvier 2025.
En parallèle, une nouvelle profession se développe : les coordinateurs d’intimité. Ces personnes (souvent des femmes) accompagnent la mise en scène et les interprètes dans la création des scènes intimes. L’objectif ? S’assurer que les interprètes se sentent en sécurité en ayant pu exprimer leurs limites et donner clairement leur consentement tout au long du processus créatif. « On passe d’une culture du silence à une culture de la vigilance », observe un membre du Collectif 50/50. Ces dispositifs ne sont pas seulement des garde-fous, mais de véritables leviers pour instaurer une nouvelle culture de travail respectueuse.
Le cinéma, levier crucial dans la représentation de la diversité
Longtemps critiqué pour son manque de représentativité, le cinéma français prend aujourd’hui la mesure de son rôle de miroir social. La représentation de la diversité est d’ailleurs aidée par plusieurs dispositifs structurants. Parmi eux, le Fonds Images de la diversité du CNC avec le soutien de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, finance depuis 2007 aussi bien l’écriture que la production de films qui contribuent à une représentation plus fidèle de la société française à l’écran. Ce soutien se traduit par des projets puissants comme L’Histoire de Souleymane, récompensé au Festival de Cannes 2024 dans la catégorie Un Certain Regard.
Quand inclusion rime avec succès
La représentation du handicap, longtemps marginalisée, connaît désormais un nouvel élan sur le grand écran. Un exemple marquant : celui du film Un P’tit truc en plus, réalisé par Artus en 2024, qui a réuni dix comédiens en situation de handicap à son casting. Pour garantir des conditions adaptées et faciliter la communication entre l’équipe technique et ces acteurs, un poste inédit a été créé : le coordinateur régie-handicap. Ce rôle consiste à accompagner les comédiens au quotidien, à anticiper leurs besoins spécifiques (accessibilité, compréhension des consignes, gestion du rythme) et à sensibiliser le reste de l’équipe. Cette innovation a non seulement permis le bon déroulement du tournage, mais a aussi ouvert la voie à la reconnaissance officielle de ce métier dans la convention collective. Une démarche qui illustre combien l’inclusion, loin d’être une contrainte, enrichit la créativité et peut déboucher sur un énorme succès populaire, le film ayant dépassé les 10 millions d’entrées.
Quelles leçons pour le monde du travail ?
Si l’industrie du cinéma donne une visibilité particulière à ces mutations, celles-ci sont transposables à tous les secteurs. Et les entreprises de tous horizons peuvent elles aussi s’inspirer de ces initiatives pour accélérer leurs propres transformations.
1ère leçon : l’obligation légale comme tremplin
Les obligations légales, même si elles sont simplement déclaratives (comme les bilans carbones demandés par le CNC) peuvent amorcer une dynamique sur le terrain. La création du rôle de coordinateur d’éco-production démontre tout l’intérêt des fonctions dédiées pour piloter la transition écologique. Dans l’entreprise, cela invite à dépasser le simple reporting RSE pour intégrer une logique de durabilité à chaque étape des projets. Et pour cause, ralentir les cadences de production pour trouver des solutions plus responsables est aussi un levier à considérer pour le bien-être et la qualité.
2ème leçon : de la culture du silence à la culture de la vigilance
Sur les plateaux, la généralisation des formations contre les violences sexistes et sexuelles, ou la présence des coordinateurs d’intimité, prouvent l’efficacité des dispositifs visant à instaurer une nouvelle culture du travail portée sur la vigilance. En investissant dans la formation managériale et en mettant en place des référents indépendants, elles peuvent développer un climat où chacun peut exprimer ses limites sans crainte de représailles et ainsi renforcer la confiance et la performance collective.
3ème leçon : L’inclusion comme catalyseur de valeurs
L’expérience du coordinateur régie-handicap démontre qu’intégrer la diversité n’est pas qu’une question de conformité, mais un moyen puissant de stimuler la créativité et le succès commercial. Pour y parvenir, cela nécessite d’adapter les méthodes de recrutement et les espaces de travail, mais surtout de créer des rôles d’accompagnement spécialisés pour lever les freins.
Les transitions ne se font pas sans remous. Si elles bousculent nos équilibres, elles ouvrent également de nouvelles perspectives. Le cinéma nous rappelle qu’il est impératif de dépasser les appréhensions pour développer une culture du travail bienveillante, responsable et, in fine, plus performante.
Thibaut Deville