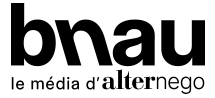Lundi 23 juin, le conclave sur les retraites s’est conclu sur un constat d’échec. Les deux parties syndicales et patronales n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur des modalités d’évolution de la réforme de 2023.
Cette absence d’accord place le gouvernement dans une situation délicate en l’exposant de nouveau à la censure qui avait été repoussée en raison de l’annonce de cette négociation. Elle acte par ailleurs une nouvelle fois la difficulté à élaborer un compromis entre partenaires sociaux quand le pouvoir exécutif cherche à excessivement encadrer ou vient parasiter les discussions. Alors, quels enseignements peut-on en tirer de cet événement ? Décryptage avec Jean-François Poupard.
Quel était l’objectif de ce conclave ?
Jean-François Poupard : Cette négociation était au départ une demande du gouvernement de François Bayrou, qui avait souhaité rouvrir cette phase de dialogue entre partenaires sociaux afin de ne pas subir une motion de censure de son gouvernement.
L’objectif affiché était de permettre de modifier certains paramètres (y compris l’âge de départ) afin « d’améliorer » la réforme de 2023, qui avait, on s’en souvient, soulevé une très forte opposition populaire.
Dès le départ on voit donc que le conclave (terme au passage quelque peu impropre pour une négociation étalée sur 4 mois…) était une initiative étatique et qui répondait davantage à une attente des syndicats plutôt que de la partie patronale.
Pourquoi cet échec ?
Jean-François Poupard : Plusieurs facteurs peuvent nous permettre d’expliquer ce dénouement. Tout d’abord, cette négociation a été imposée par le gouvernement et s’est tenue sous une double contrainte : de temps, mais surtout avec un impératif imposé dès le départ de ne pas alourdir les coûts de financement. De plus, des interventions intempestives des pouvoirs publics ont rapidement interféré : on pense à la déclaration du Premier ministre excluant de revenir sur l’âge de 64 ans, mais également de la Cour des Comptes ou du COR (Comité d’Orientation des Retraites) qui ont publié des rapports pendant que les négociateurs travaillaient.
Autre facteur plus structurel, les négociations interprofessionnelles se caractérisent par le grand nombre d’acteurs qu’elles impliquent, avec 3 organisations côté patronal et 5 du côté syndical. Cela n’empêche pas que des ANI (Accords Nationaux Interprofessionnels, NDLR) soient régulièrement signés, mais cela conduit à une multiplication des revendications et des « lignes rouges » de part et d’autre, rendant difficile de trouver des zones d’accords.
Enfin, les stratégies de négociation ont été très différentes selon les syndicats : deux d’entre eux (FO puis CGT) ont choisi de quitter la table des négociations faute de pouvoir espérer obtenir une avancée sur leur principale revendication (le retour à 62 ans de l’âge légal), tandis que les 3 autres ont poursuivi les discussions afin d’obtenir des avancées sur d’autres points (pénibilité, âge d’annulation de la décote…). Ces stratégies renvoient à une conception distincte de la négociation : faute de rapport de force suffisant pour obtenir du patronat un recul sur les 64 ans, FO et CGT ont préféré arrêter les discussions dans l’espoir d’obtenir davantage lors des débats au Parlement, tandis que CFDT, CFE-CGC et CFTC ont privilégié l’approche contractuelle et la primauté d’un accord entre partenaires sociaux.
Quels enjeux pour la suite ?
Jean-François Poupard : Les syndicats ayant refusé la prolongation des discussions proposée par le gouvernement, ce dernier devrait maintenant reprendre la main et proposer au Parlement un texte construit autour des points d’accord qui sont ressortis lors des discussions. L’écriture de ce texte ne sera toutefois pas chose aisée car les points en suspens (autour de la prise en compte de la pénibilité notamment) ne sont pas simples à démêler. Une fois de plus, l’échec de la négociation revient donc à redonner la primauté au pouvoir législatif plutôt qu’à la construction de solutions par les partenaires sociaux.
Toutefois un point positif à retenir de cette négociation est l’innovation dans la forme. Contrairement aux autres négociations interprofessionnelles, les discussions ne se sont pas tenues au siège du MEDEF et sur la base de textes rédigés par eux. Elles ont eu lieu dans un espace neutre, sous l’égide d’un pilote désigné par le gouvernement, ainsi que sur la base de textes rédigés par lui avec l’appui de hauts fonctionnaires, et non par le MEDEF.
Ces modalités plus équilibrées de dialogue ont été saluées par les syndicats ayant pris part aux discussions jusqu’à son terme. Le MEDEF en revanche a pu sembler déstabilisé par le changement de posture que signifiait cette méthode innovante. Cela a d’ailleurs aussi révélé des dissensions inhabituelles au sein de la délégation patronale, avec le départ de l’U2P puis des prises de position de la CPME distinctes du MEDEF. Il sera donc intéressant de voir si le patronat acceptera de reconduire ces modalités de dialogue pour de futures négociations, face à un modèle qui a montré ses limites.