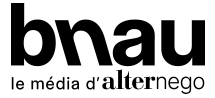Le diagnostic de burn-out, parfois galvaudé, est souvent utilisé pour désigner un état dépressif ou encore une période de grande fatigue. Pourtant il s’agit avant tout d’un terme clinique aux symptômes bien précis, qui désigne le syndrome d’épuisement professionnel. Épuisement à la fois émotionnel, physique et psychique d’après le modèle de Maslach et Jackson. On parle de « pathologie du surinvestissement au travail » dans la mesure où le burn-out nait de la rencontre entre un individu et une situation de travail dégradée.
« Véritable processus de dégradation qui s’inscrit dans la durée » s’accordent à dire les deux psychologues cliniciennes, Laurence de Malartic et Victoria Tchakmazian, le burn-out peut même mettre des semaines, des mois, voire des années à se révéler. Celui-ci passe par de nombreuses manifestations qui impactent le comportement et la santé de l’individu. Alors comment cet état psychologique peut-il mettre tant de temps à s’installer sans être détecté, autant du côté de l’employeur que du salarié lui-même ?
Le déni comme lutte contre l’effondrement
Au fur et à mesure que l’on avance dans le temps, les manifestations symptomatiques du burn-out se distinguent en quatre phases. « La première que l’on peut observer est la satisfaction que produit l’investissement professionnel, observe Laurence de Malartic.
La seconde, quant à elle, porte sur le sur engagement provoqué par l’investissement dans le travail. » Et c’est bien souvent au cours de ce stade que l’entourage professionnel et personnel commence à interroger la mise en danger de la personne concernée. Les lanceurs d’alerte cherchent alors à la faire ralentir, mais se retrouvent face à une personne qui rassure, assure que ça va aller, qu’elle peut gérer. Et pour cause, c’est la phase de résistance qui parle à sa place. Autrement dit, la troisième étape du processus empêche à la fois la personne atteinte et l’entourage de réaliser réellement ce qui est en train de se passer.
Durant cette étape clé du processus de dégradation, l’individu a déjà bien entamé sa baisse motivationnelle, la fatigue commence à peser… les ressources en termes de compétences et d’énergie atteignent leurs limites. Pourtant, c’est aussi paradoxalement le moment, où la négation est à son paroxysme. « Négation à la fois du surmenage et de la charge de travail, associée à la diminution de l’estime de soi, l’augmentation de l’anxiété et aux difficultés cognitives (concentration, mémorisation, traitement de l’information…)», poursuit la psychologue. Le déni agit alors comme vernis pour camoufler une réalité qui n’est plus supportable et avouable. « La phase de résistance vient révéler une lutte intérieure entre l’épuisement subi et la volonté inconsciente de s’opposer à cette réalité », décritVictoria Tchakmazian, rappelant par la même occasion que le déni est d’ailleurs un « mécanisme de défense » au service de la survie du sujet. C’est cette dualité qui perpétue l’épuisement jusqu’à atteindre cet état de stress dépassé. À savoir la quatrième phase, qu’on appelle aussi l’effondrement. Mais quelle réalité veut-on ici combattre pour ne pas sombrer ?
Le déni comme lutte contre soi-même
Lorsque notre inconscient vient nier l’épuisement professionnel qu’il subit, c’est son propre rapporte à l’estime de soi qu’il cherche à éviter. « Si je reconnais que je n’en peux plus, que je suis fatiguée, que je n’arrive pas à remplir mes missions, cela me renvoie une image défaillante de moi-même », expliqueLaurence de Malartic.Et c’est bien par l’impossibilité d’accepter l’image qui m’est renvoyée par mon état que se manifeste le lien de corrélation entre le déni et le burn-out. « Un sentiment de défaite vis-à-vis de soi et des autres qui est insupportable pour de nombreux individus, traduit Victoria Tchakmazian. À un niveau très inconscient bien sûr, mais présent malgré tout. »
Si le rapport aux autres peut entretenir une forme de pression, c’est surtout le rapport à soi-même qui prédomine dans l’analyse du déni. Et c’est ici que le concept de « moi idéal » entre en jeu. « Pour Freud, le moi idéal, c’est une image très valorisée, surdimensionnée de soi que l’on a besoin de présenter aux autres afin de montrer le meilleur de nous-mêmes », explique Victoria Tchakmazian. Alors quand le burn-out aboutit à son lent processus de dégradation, c’est l’estime et l’amour qu’on se porte à soi qui se retrouvent affaiblis. « Les psychanalystes vont d’ailleurs désigner l’abandon de cette image fantasmée par un effondrement de ce moi idéal », ajoute Laurence de Malartic. Étape finale du processus de burn-out dont la conséquence physique se traduit littéralement par le fait de ne plus « pouvoir mettre le pied par terre ».
Sortir du déni : la nécessité d’une double prise en charge
Si la phase d’effondrement de l’individu est parfois impossible à empêcher au vu de l’épuisement traversé sur une période plus ou moins longue, il peut dans certains cas être évité. Pour tenter de lever le déni à temps, un double accompagnement est nécessaire. « L’entreprise a évidemment un rôle à jouer dans la perception de la réalité de l’organisation du travail pour restaurer un cadre bienveillant, à l’écoute et des conditions de travail acceptables. », énonce Victoria Tchakmazian, en s’équipant pour repérer les signaux faibles manifestés par le sujet en risque de burn-out, et en mobilisant l’ensemble des acteurs internes à l’entreprise pour éviter que la situation se dégrade, autant dans le management par des formations sur les risques psychosociaux et une sensibilisation à l’écoute active (technique de réception de parole, NDLR), qu’au niveau des équipes par un apprentissage de co-vigilance, de co-responsabilité et d’attention à l’autre. « Mais on ne peut pas non plus imputer à l’employeur la seule responsabilité du burn-out, et par conséquent n’être que le seul soutien possible », temporise Laurence de Malartic. Notamment en raison de la part du déni qui empêche la visibilité du burn-out et l’articulation « propre à ce syndrome entre le contexte du travail et la personne en question », poursuit la psychologue. Si l’organisation a un rôle à jouer, l’individu se doit aussi d’assurer le sien.
Le salarié doit alors être accompagné par un psychothérapeute pour lever ce mécanisme de défense très ancré qu’est le déni et étayer les troubles associés. Cela nécessite de s’interroger : quel est mon rapport au travail ? Quels sont mes lieux d’investissement autres que le travail ? Comment renouer avec d’autres espaces d’engagement extra-professionnels (personnels, sportifs, culturels, associatifs… )? « L’objectif est de faire réaliser au sujet que son surinvestissement dépend sans doute d’une croyance personnelle selon laquelle le travail définirait qui l’on est. Autrement dit, réduire la personne à sa fonction professionnelle au détriment de sa globalité en tant que personne à part entière. », nous apprend Victoria Tchakmazian. « Ainsi la prise en charge psychothérapeutique permet de déconstruire cette représentation d’une identité majoritairement construite par rapport au métier, pour restaurer l’identité globale de la personne dans son rapport au monde professionnel et personnel. », indique Laurence de Malartic. L’accompagnement est long de la même manière que le processus met du temps à se révéler. La guérison est elle-aussi progressive et s’inscrit dans le temps.
Vers une interrogation de la culture en toile de fond
Enfin il est difficile de parler de déni dans le burn-out sans évoquer le contexte dans lequel évolue le professionnel dans sa situation de travail et dans la société actuelle. Culture organisationnelle de l’entreprise, qui autorise les individus (ou non) à aller voir les managers, à parler de ces sujets. « Cette démarche dépend de l’autorisation implicite et explicite à aborder les questions de santé mentale au quotidien, sans peur d’être stigmatisé, soulèveLaurence de Malartic, en créant des espaces de paroles, de régulation et un environnement de travail adapté. »
Mais ce n’est pas tout, la dimension sociétale est elle aussi à interroger. « Notre société vient renforcer chez l’individu cette reconnaissance par le niveau d’investissement dans sa profession et l’invitation à refuser toute forme de limites », affirme Victoria Tchakmazian. Ainsi, le travail revêt aujourd’hui une importance telle qu’il vient poser la question fondamentale des ressources. De la famille, aux amis, à l’école, jusqu’au travail, en passant par les études… Les différents cercles sociaux qui fondent notre rapport au monde, tout notre système semble propice au surinvestissement qui favorise la construction du « moi idéal ». Au détriment de la santé. Or on ne peut pas nier éternellement le principe de limite, dans notre capacité à consommer, à puiser, à supporter… Nulle ressource est illimitée et c’est désormais tout notre écosystème qui s’épuise jusqu’à un point de non-retour. L’urgence est donc à l’économie d’énergie dans sa globalité, à l’écoute de ses capacités réelles et à l’acceptation de ses signaux faibles qui viennent nous alerter. C’est peut-être alors le seuil tolérance vis-à-vis des autres et de soi-même qu’il faudrait commencer par assouplir. À défaut d’être entièrement repensé.